Menu blogs
Depuis quelques semaines, je me rends au travail sans grande conviction. Je m’apparente plus à un robot qu’à un être humain. Mais il faut bien que je paie mes factures et surtout mes extras…
C’est vrai que côté finances, je suis souvent dans le rouge et la poudre a eu raison de mes maigres économies.
J’achète de l’héroïne tous les week-ends. l’héroïne gère mon existence tout entière, et, sans résistance, je la laisse me mener par le bout du nez. J’ai mon rituel. Je m’arrête à Bourg-Madame, à l’hôtel du Colorado, saluer Xavier, je bois un verre puis je file chez Kiko et Yefi où nous refaisons le monde à notre façon.
Ils trouvent que je joue avec le feu. Kiko m’a dit que je ferais mieux d’ouvrir les yeux et de voir enfin toute la chance que j’ai d’avoir une famille, des amis qui ne demande qu’à m’aider, qu’à m’aimer. Que j’avais un bon boulot et que je risquais de perdre tout à cause de l’héroïne. C’est vrai que je n’ai rien vu venir. Je me sens complètement dépassée, sans aucune capacité d’introspection sur ce que je fais réellement de ma vie. Je n’ai pas choisi la santé, le travail ou mes amis, j’ai choisi la came.
Dans les couloirs, je croise souvent Julien, et même si j’essaie de donner le change, je vois bien qu’il n’est pas dupe. Mon imagination n’a plus de limites et j’arrive toujours à trouver une raison auprès de lui expliquant ma fatigue, ma pâleur, mais aussi ma froideur. J’évite au maximum de rester seule avec lui pour ne pas avoir à parler, à m’expliquer une énième fois.
J’ai pris beaucoup de distance avec mes amis, Julien, mais aussi avec Cathy, mes collègues de travail et ma famille.
Au centre, j’ai sympathisé avec une femme d’une soixantaine d’années atteinte de sclérose en plaques. Elle est adorable. Elle ne me pose jamais de question, je crois qu’elle m’aime bien. Mme Angeli est veuve depuis dix ans et vie à travers ses souvenirs. Elle me parle souvent de son mari qui est mort dix ans plus tôt, il était toute sa vie. Il m’arrive parfois d’aller dans sa chambre juste pour l’écouter parler de son époque qui me paraît si lointaine, quand le travail me le permet, j’évite en même temps de rester en tête à tête avec Marielle, qui se doute de quelque chose.
Je m’assois au bord de son lit et nous papotons. Ses doigts sont tellement déformés qu’elle ne peut même plus serrer un objet dans ses mains. Parfois, je la coiffe, juste pour lui faire plaisir, elle aime bien. Elle encaisse des douleurs atroces que son traitement pourtant très lourd apaise à peine. Sa chambre est devenue mon refuge… Nous nous ressemblons un peu, toutes les deux, elle, le corps brisé et déformé par la maladie, moi, le cœur en miettes abîmé par tout ce que la vie m’a fait encaisser.
Nous sommes début décembre. Une période que je redoute. La route est dangereuse, la neige et le verglas m’oblige à la plus grande des attentions et m’oblige à rester parfois cloîtrée chez moi.
Mais ce week-end, même si la météo annoncée n’est pas des plus optimistes, je dois absolument aller à Puigcerda. Je n’ai plus de stock et il faut vraiment que je voie Louis.
Je sors du centre. La nuit glaciale s’est abattue sur la vallée, mordant la peau de mon visage et de mes mains découvertes. Le ciel est bas, saturé de nuages, le vent s’engouffre sous mon manteau, je relève mon col, je marche vite vers ma voiture.
Sur le parking, j’aperçois Julien dans sa voiture. Mince. J’hésite à faire demi-tour, mais il m’a vu. Il me regarde, ouvre sa portière et me fait signe de monter.
— Salut Julien… J’étais pressée, je dois rentrer.
— Monte, il fait un froid de chien, me dit-il en ouvrant la portière côté passager.
Je ne proteste pas et m’exécute. Julien me regarde l’air préoccupé.
— Tu allais où si vite ?
— Ben… Chez moi.
— J’ai l’impression que tu m’évites… Je me trompe ?
— Ben… Oui !
J’ai du mal à soutenir son regard, j’ai l’impression qu’il lit en moi comme dans un livre ouvert. Je baisse les yeux et tripote mon porte-clés frénétiquement.
— Ok… Je voulais te proposer de réparer ta voiture ce week-end, bon, je ne suis pas mécano, mais je peux tenter d’arranger ça.
— Oh wow… C’est gentil, Julien, je vais voir ça. Je t’appellerai… Ok ?
— J’espère…
— Sinon… Comment tu vas ?
— Ça va… J’ai pas très envie de parler là…
— Pourtant, tu devrais… Je t’assure ! Je ne suis pas dupe, tu sais, tu tires toujours une tête pas possible, au boulot, t’es ailleurs, tu es blanche comme un linge, tu disparais à toutes les pauses, Rosy, tu te fous en l’air à petit feu ! Ouvre les yeux !
— Tu exagères…
Dans l’habitacle, seul le ronronnement du moteur et la soufflerie du chauffage brisent un silence gênant. J’ai vraiment le sentiment que Julien veut m’aider et à ce moment précis, j’ai juste envie de le rassurer, de le prendre dans mes bras et de le serrer très fort.
Je lève les yeux quand son regard accroche le mien. Sa main effleure la mienne, je ne bouge pas. Il s’approche. Nos lèvres se trouvent dans un frôlement timide, presque comme un questionnement, puis son souffle se mêle au mien, sa paume glisse derrière ma nuque et ce baiser devient plus intense et totalement consenti. Lorsque Julien relâche sa courte étreinte, je suis un peu étourdie et mille questions me traversent l’esprit, encore des questions… Pourquoi chez moi rien ne peut être simple, tout simplement ?
— Rosy… Il y a tellement longtemps que je rêve de t’embrasser...
— Julien, je ne peux pas te faire ça… Je suis désolée… Je n’aurais pas dû !
— Me faire quoi ?
— Te faire croire à une histoire, nous deux… Pour l’instant… J’ai mes problèmes à régler avant, tu le sais, c’est à moi, à moi seule de m’en sortir.
— Rosy…
— S’il te plaît…
J’ouvre la portière et pars rejoindre ma voiture, sans me retourner. J’ai de la peine pour Julien, pour moi, pour nous. Si je dépensais autant d’énergie à cultiver mon bonheur qu’à l’anéantir, ma vie serait plus agréable… Et celle des gens autour de moi, infiniment plus paisible.
Sur le parking, Julien n’a toujours pas démarré. J’ai une envie folle d’aller le rejoindre, mais je pars et passe la barrière du parking. Je fuis. Une fois encore.
Je me retrouve, à nouveau sur cette route, seule, qui me mène à la défonce. Je ne prends même plus la peine de repasser chez moi, je fonce. Depuis une heure, déjà, la nuit a tout englouti. Le bitume brille par endroits, verglacé, je redouble de prudence. Puis, la neige commence à tomber, fine, couvrant les bas-côtés d’un voile léger. Je passe enfin le col de la Perche, endroit le plus critique, plus que quelques kilomètres.
Lorsque j’arrive enfin à Puigcerda, je me gare derrière le Club 32. Je coupe le moteur et reste un instant immobile. Je ne me sens franchement pas bien du tout, j’ai mal partout, j’ai des sueurs froides et j’ai presque la nausée.
Je marche un peu et entre à la Marinesca. Une odeur de graisse rance me saute à la gorge dès que j’arrive, c’est très désagréable. Louis n’est pas là. Je salue le barman et m’installe sur un tabouret près du bar et commande une San Miguel. La mama est là, elle n’a pas quitté son tablier, il est toujours aussi crade. Elle nettoie les broches sur lesquelles elle enfile avec hargne les pauvres poulets toute la journée. Plus de massacre pour ce soir, elle range ses armes.
L’attente est interminable. Je ne suis même pas sûre que Louis va venir. Je suis de plus en plus. Le pire reste peut-être cette envie violente qui me fait mal au plus profond de mes tripes. Il faut que je pense à autre chose…
J’observe la mama. Je n’ai que ça à faire. Elle s’attaque maintenant au trottoir, juste devant l’énorme rôtissoire installée dehors. Elle ne fait pas dans la dentelle, fermement décidée à faire la guerre à toute la graisse qui a dégouliné. Elle balance des seaux d’eau que son fils lui passe. Le spectacle est total : une chorégraphie de gestes brusques, complétée par quelques coups de balai espagnol énergiques, aux franges noircies de crasse. Elle frotte comme si sa vie en dépendait. Chaque jet d’eau éclabousse jusqu’à la chaussée.
Une bonne heure a dû passer et Louis n’est toujours pas là. Je reprends une bière, histoire de ne pas me faire jeter du bar. Je la crois capable de tout, cette femme. Elle est franchement antipathique, ou alors, c’est moi qui ai une tête qui ne lui revient pas. C’est sûrement ça.
Et si Louis ne venait pas… Cette pensée m’horrifie et me ramène brusquement à la réalité. Je deviens une junkie ? Les douleurs dans mes os sont de plus en plus insupportables. L’odeur de volailles brûlée, mêlée à celle du détergent, me remonte à la gorge. J’en suis vraiment arrivée là ? Si Julien me voyait… Il deviendrait fou.
Il recommence à neiger légèrement. J’angoisse déjà pour la route du retour. Enfin, le soulagement, tout mon corps se met à frissonner, à la limite du supportable. Louis entre, salue la mama et son fils, puis enlève son blouson saupoudré de neige. En un coup d’œil, il a compris que je l’attendais depuis longtemps. Il me sourit et s’installe près de moi et me demande combien j’en veux. Je lui achète deux grammes pour le week-end, puis il m’explique dans un Français approximatif :
— Fais attention, j’arribe dé Barcelone, j’ai pas touché, peut-être fort, ok ?
— Ok ! Gracias
Que ces mots sont doux à mon oreille ! Je file sans saluer la mama qui ne m’a même pas calculée pendant deux heures et demie. Je décide de me shooter au club 32, je l’ai déjà fait, quand il n’y a pas grand monde, je peux monopoliser les toilettes quelques minutes sans éveiller les soupçons. Il y a de la lumière et surtout, il y a de l’eau. Il fait bien trop froid pour le faire dans la voiture, déjà que je suis crispée, ça serait une catastrophe.
Il n’est pas loin de minuit quand j’entre dans les toilettes. Je suis très organisée maintenant, mes gestes sont sûrs et je me pique sans aucune hésitation. Une fois la seringue remplie, je range tout dans mon sac. Je m’installe aussi confortablement que l’on peut être sur des toilettes. Je pose le garrot et j’enfonce enfin l’aiguille. J’aspire légèrement pour m’assurer d’être bien dans la veine, le mélange se teinte aussitôt de rouge, j’enfonce le piston. Une vague de chaleur m’emporte tandis qu’une sensation inhabituelle me traverse la colonne vertébrale. Une déflagration de plaisir brutal me force à inspirer profondément pour ne pas m’évanouir… La musique s’estompe… S’éloigne… Le silence.
J’entends des bruits curieux, des voix lointaines… Ma poitrine me fait mal, ma bouche est sèche. J’essaie de bouger, mais mes mouvements semblent désordonnés. Je peux à peine relever la tête.
Les voix se font plus distinctes et me demandent d’ouvrir les yeux, encore et encore. Les bruits se font plus clairs et résonnent autour de moi, obstinés, mécaniques, comme des bips réguliers.
J’arrive enfin à ouvrir les yeux. Autour de moi, trois personnes s’affairent. Je réalise que je suis à l’hôpital. Un médecin se penche au-dessus de moi.
— Mademoiselle ! Ouvrez les yeux ! Voilà… Restez avec nous. Vous êtes à l’hôpital… Mademoiselle ! Comment vous vous appelez ?
Mon Dieu, non… Je suis sur un brancard, torse-nu. Des électrodes collées à ma peau me relient à un monitoring, un tensiomètre me serre le bras à intervalles réguliers. Ma tête bourdonne, c’est une horreur. L’odeur d’éther me donne un haut-le-cœur. Un cathéter me relie à une perfusion… Et puis les voix s’éloignent à nouveau…
— Hey ! Réveillez-vous ! Mademoiselle !
Une main écrase un masque à oxygène sur mon visage.
— Voilà… Respirez normalement… Tout va bien…
J’arrive enfin à émerger. Je respire beaucoup mieux. J’essaie de me redresser.
— Non… Doucement ! Restez allongée !
Je n’ai qu’une idée en tête : m’enfuir d’ici. Je suis obsédée par la peur que l’hôpital ai prévenu la guardia civil à la frontière avec mon signalement. Il, y a-t-il une possibilité pour qu’ils viennent directement me cueillir ici ? Avec plus d’un gramme d’héroïne dans mon sac, ça leur suffirait largement pour me mettre en tôle… Il faut que je me tire, et vite !
Je commence à m’agiter et j’arrache le cathéter de mon bras. Le sang jaillit, éclaboussant le drap sur le bord du brancard. L’infirmière accourt, une compresse à la main, en souffle d’exaspération et appuie fort sur mon bras. Je sens la panique monter. Je ne vais pas réussir à me dépêtrer de cette situation.
Le médecin revient, me regarde d’un air grave.
— Calmez-vous… S’il vous plaît… Vous vous appelez comment ?
— Rosy, je m’appelle Rosy… Je vais bien… Je veux partir d’ici.
— Rosy, vous venez de faire un arrêt cardiaque ! On a dû vous réanimer…
Je reste un moment interloqué, sans répartie. Un arrêt cardiaque ? Comment s’est possible ça ? Il exagère…
— Mais je vais bien maintenant, je peux vous signer une décharge ?
— Ce n’est pas vraiment pas prudent, Rosy, vous devriez rester chez nous au moins vingt-quatre heures.
— Non !
Le médecin s’adresse à l’infirmière en espagnol. Elle sort de la pièce et revient avec une liasse de documents. Je me lève malgré leur regard désapprobateur. J’essaie d’enfiler mon soutien-gorge, mais je m’aperçois qu’ils l’ont découpé au ciseau, dans l’urgence, je suppose, en plein milieu. Mon regard s’arrête sur une énorme pendule sur le mur. Je n’en reviens pas, il est presque trois heures du matin !?
Je termine de m’habiller. Mes gestes sont lents et maladroits. Je remplis rapidement les papiers, en inventant un nom et une adresse bidon. L’infirmière me conduit jusqu’à la porte sans un mot. Il règne une drôle d’ambiance. Est-ce que j’ai vraiment failli mourir ce soir ?
Je marche, un peu hébétée, jusqu’à la voiture. Mes oreilles bourdonnent encore. J’ai la nausée et la sensation étrange, désagréable, d’avoir des débuts de crampes dans chaque muscle de mon corps.
Je fouille mon sac pour m’assurer que j’ai toujours mon matériel et la poudre. Rien ne manque, je suis soulagée. Mon cerveau continue à bouillonner. Et si, à la frontière, la guardia civil me fouillait ?
Si seulement je pouvais laisser mon matos à Xavier pour qu’il le passe de l’autre côté… Je pourrais le récupérer dans la matinée au Colorado. Ce sera plus sûr. Peut-être que je me fais une grosse crise de paranoïa, mais je n’ai pas envie de prendre de risque.
À la hauteur du club 32, j’hésite. Le spectacle que je leur ai offert ce soir est déjà suffisant ; inutile d’en rajouter avec ma tête de revenant. C’est plus fort que moi. J’entre.
Dès que Paco m’aperçoit, il blêmit. Il fait signe au patron que tout va bien et s’avance vers moi, la mâchoire serrée.
— Rosy… Qu’est-ce que tu fous là ? T’as failli crever, merde !
Sa voix n’a rien d’agressif, c’est plus de la peur que du reproche.
— Fais-toi un peu oublier, le patron ne veut plus te voir ici pour l'instant !
— Je m’en doute, désolée, je cherche Xavier…
— Oui, il est là, je te l’envoie. Rentre chez toi, Rosy.
Je monte l’escalier quand j’entends Xavier.
— Mais putain ! T’as fait quoi là ! Me dit-il, hors de lui, en enfilant son blouson, t’es sorti de l’hôpital ? Sérieux ! Rosy…
Xavier me fait la morale, encore et encore, j’en ai marre, j’ai l’impression que ce soir, le monde entier est contre moi. Il accepte de passer la frontière avec la came. Il m’explique que des copains se sont fait arrêter pour moins que ça. Je la cache à la place de la pellicule, dans un petit appareil photo jetable, certes, ce n’est pas très original, mais ça me rassure.
— On est bien d’accord, tu n’y touches pas, Xavier ?
— Mais non, t’inquiète pas, Rosy, là, je rentre, je vais dormir un peu, je commence à travailler à cinq heures, tu passes quand tu veux récupérer ton matos !
Je le salue et le remercie chaleureusement, puis je pars vers la voiture. Il va falloir que je tue le temps pendant presque deux heures et surtout que je me réchauffe. Je démarre le moteur, mais le chauffage n’est pas du tout efficace à l’arrêt. La neige a déposé une fine couche sur le pare-brise et les vitres, la transformant en un cocon silencieux et cotonneux. Je récupère une veste et deux grosses écharpes, je recule mon siège et je me cale, recroquevillée devant le volant. J’essaie de me détendre. Je ferme les yeux. Mon corps est épuisé et se relâche…
Des tremblements frénétiques me réveillent en sursaut. Je regarde l’heure, wow… J’ai dormi deux heures ! Je suis glacée. Je remets tout en place et tourne la clé. Le moteur toussote, hésite, puis finit par démarrer, à mon grand soulagement.
— Ce n’est vraiment pas le moment de me lâcher, ma belle !
Je roule un peu et le chauffage se fait doucement efficace. Mon corps est à bout. Je claque des dents. Je n’arrive pas à me calmer. Je me gare devant le lac sans couper le moteur. Les phares se reflètent sur la surface gelée. Tout est silencieux, immobile. Je reste là, les mains crispées sur le volant et d’un coup, je craque. Je me mets à pleurer comme une enfant. De peur, de fatigue ou de honte, je ne sais pas vraiment.
Je réalise que j’aurais pu mourir, seule, dans cet hôpital, loin de tout ce que j’aime, de tout ce qui me reste encore. Cette idée me transperce et me glace le sang.
Peu à peu, les larmes s’épuisent, je respire mieux, la tension retombe. Je me sens prête à rouler, passer la frontière et récupérer l’appareil photo auprès de Xavier.
Lorsque je passe à hauteur du poste-frontière, les douaniers ne sortent même pas des locaux et me font juste le signe de passer de la main. Je me gare près du parking du Colorado.
J’entre, commande un café et demande Xavier. Le serveur me répond d’une voix irritée :
— Xavier ? Pfff, ça fait une semaine qu’il a commencé et il n’est même pas foutu d’être à l’heure !
— Il n’a pas pris son service ?!
— Non !
Une vision d’horreur me traverse aussitôt l’esprit, violente, insoutenable, que j’essaie de chasser aussitôt, les mâchoires serrées. Je tente de me raisonner. Il doit dormir encore, il n’a pas entendu le réveil. C’est ça… Mais la peur s’installe en moi et je commence à paniquer. Non… Il n’a pas fait ça ! Il m’avait promis…
Je demande aussitôt le numéro de sa chambre, la voix tremblante, pour en avoir le cœur net.
Je monte à l’étage. Une employée range du linge sur son chariot, je la salue, elle me toise, je dois avoir une sale tête. Je trouve enfin la porte de la chambre et frappe. Rien… Je frappe plus fort, puis tambourine. Aucune réponse.
— Xavier, par pitié… répond !
Je retourne vers l’employée, qui me regarde d’un air inquiet, et lui demande une clé. Elle hésite, recule un peu. J’insiste avec une voix plus ferme et exaspérée :
— Il faut ouvrir, s’il vous plait ! C’est pas normal ! Il se passe quelque chose ! Restez avec moi si vous voulez ?
Elle finit par céder enfin, tourne la clé et pousse la porte. Un cri lui échappe, bref, étranglé, avant qu’elle ne s’enfuie dans l’escalier en courant.
J’entre. Tout près du lit, Xavier gît au sol, recroquevillé sur lui-même, la peau marbrée, le corps boursouflé, il est mort…
Un coup me traverse la poitrine. Je suis dévastée, anéantie. Je reste immobile, incapable de bouger. Mais qu’est-ce que j’ai fait ? Mon regard accroche l’appareil photo posé sur son bureau. Sans réfléchir, je le saisis, pousse la fenêtre et le balance en contrebas dans un buisson. Il vaut mieux que personne ne trouve ça ici.
Je tourne les talons et m’enfuis comme une voleuse, en larmes, le souffle court, la gorge serrée.
Au bout du couloir, j’entends des voix et des pas qui raisonnent. Le patron, suivi de deux employés, me voit et s’arrête.
— Qu’est-ce qui se passe ici ?
Je balbutie, la voix étranglée :
— C’est Xavier… Dans sa chambre… Il est mort.
Le patron me dépasse sans attendre, pousse la porte. Le barman le suit. Un silence, puis un juron étouffé. L’autre homme reste avec moi, il pose une main maladroite sur mon épaule.
— Venez, on descend.
Incapable de lui répondre, je le suis. Au bar, on me fait asseoir. Le bruit de la machine à café me semble lointain, comme étouffé. On me tend un café brûlant, je tiens la tasse sans même boire.
Le patron redescend un moment plus tard, le visage fermé. Il parle vite, presque sans me regarder.
— La police va arriver, vous ne bougez pas. Il faudra leur expliquer ce que vous avez vu, d’accord ?
Je hoche la tête. Les mots ne sortent plus.
Si je ne lui avais pas donné cette putain d’héroïne, il ne se serait pas shooté. Il vivrait encore. Il serait en train de bosser, à râler contre les clients, à raconter ses conneries pour détendre l’ambiance ou me faire la morale.
Nous aurions encore passé des soirées chez Kiko, à rire pour rien, à fumer un peu trop, à nous croire invincibles.
Et peut-être que Lucia lui aurait fait un enfant, un jour. Ils auraient lutté contre leurs démons, auraient arrêté la dope, repris pied, construit quelque chose.
Mais non.
Je l'ai condamné.
C’est comme si j’avais moi-même tenu la seringue.
Tout s’emmêle dans ma tête, les remords me lacèrent, ma poitrine se serre, l'air me manque, j’ai du mal à respirer à nouveau, le dégoût me submerge, j’ai envie de vomir.
J’aimerais disparaître.

- cependant
Modo bougeotte - 13 octobre 2025 à 11:01
Non ce n'est pas toi...je comprends le poids de la culpabilité, mais ce n'est pas toi qui a tenu la siringue. C'était son choix. C'est triste, mais peut être réconfortant de se dire que ça été son propre choix. Un choix tragique dans une période où il n'y avait pas les outils rdr, dont les analyses pour savoir vraiment ce qu'on s'envoie !! Un choix tragique de la stigmatisation qui nous oblige de consommer en cachette, sans informer voire partager des instants avec ceux qu'on aime...

- marycora
Nouveau Psycho
- 13 octobre 2025 à 19:00
a écrit
C'était son choix. C'est triste, mais peut être réconfortant de se dire que ça été son propre choix.
Salut, non, je sais que ça sert à rien les phrases qui commencent par des si mais, franchement, Si je ne lui avais pas proposé de la passer à ma place ou Si j'étais arrivée ne serait ce qu'1 heure plus tôt, il ne serait pas mort. Cette culpabilité, je la porte depuis 40 ans, chaque année elle me pèse davantage, elle me détruit, je le sais. C'est à cause d'elle aussi que je renoue avec l'héroïne 40 ans après... En écrivant ma bio, vraiment les mots comme mes larmes arrivent tout seuls. ça devrait être thérapeutique, enfin, c'était le but aussi, mais apparemment ça me fait l'effet inverse.
Merci beaucoup pour ce gentil commentaire en tout cas. ça me touche

- marycora
Nouveau Psycho
- 17 octobre 2025 à 14:28
Zedzed a écrit
C'est ton histoire qui m'a donné envie de m'inscrire sur PA, juste pour te féliciter de la façon que tu racontes ton histoire.je suis complètement captivé
Salut,
Je suis contente si ma bio te plait ! Merci beaucoup
Tu peux, si tu veux, lire depuis le 1° chapitre aller sur un forum (tu peux y aller en invité je crois)
https://forum.ecrire-un-roman.com/viewtopic.php?t=11693
Je vais distiller quelques autres chapitres, j'ai pas fini d'écrire encore. Encouragée par un écrivain de métier, je pense m'autoéditer par la suite. Enfin, s'il me reste encore un peu de sous (mes démons me rattrapent doucement mais sûrement... 40 ans après c'est une histoire de dingue ).
Merci encore

- Jehol
Psycho junior - 22 octobre 2025 à 23:42
Content de te lire même si ton histoire est triste.
Je voulais aussi te dire qu'il faut que tu arrêtes de t'en vouloir autant, je te comprends mais ton pote était grand et responsable de son geste.
Là où il est, il veut simplement que tu vives, que tu profites au max de la vie


- Groschacha
Yogi junky
- 09 novembre 2025 à 15:13
Je lis tes textes depuis que je les ai découverts il y a quelques jours. J’aime vraiment beaucoup. L’écriture est simple mais touchante et jolie.
Tu vas sortir un livre ? J’adorerais le lire entièrement. Je vais continuer à lire tes textes sur PA.
Concernant ce chapitre, il est dur et je comprends ton sentiment de culpabilité mais comme l’ont déjà dit les autres intervenants, ton ami était lui seul responsable de ses actes. On peut évidemment toujours penser « que si », « que ça » mais ça empêche d’avancer d’abord, et puis dans ce cas on trouve toujours des arguments qui vont dans le sens de ce que l’on souhaite penser. C’est dur, c’est certain.
Je t’envoie tout le courage et la force pour ta vie du moment (je ne sais pas vraiment où tu en es). Pour ma part, j’ai commencé un traitement Subutex il y a un peu moins de deux ans, j’ai rechuté quelques mois dans l’hero il y a peu et j’ai enfin repris mon traitement il y a quelques jours. La vie est dure sans héroïne, la recherche constante d’une détente… L’ennui…
Au plaisir de te lire.
Merci pour tes partages

- marycora
Nouveau Psycho
- 09 novembre 2025 à 22:15
Groschacha a écrit
Tu vas sortir un livre ? J’adorerais le lire entièrement. Je vais continuer à lire tes textes sur PA.
Normalement oui, j'ai 2 auteurs qui me soutiennent et m'encouragent, et qui y croient. J'ai écrit 16 chapitres déjà.
Groschacha a écrit
Concernant ce chapitre, il est dur et je comprends ton sentiment de culpabilité mais comme l’ont déjà dit les autres intervenants, ton ami était lui seul responsable de ses actes.
C'est ce qu'on me dit effectivement, mais cette culpabilité est ancrée en moi depuis 40 ans...
C'est super que tu ai repris ton traitement, assez de continuer en ce sens. Oui ! La vie est dure sans héroïne, comme je te comprends... Il est urgent que tu trouves un dérivatif, tu as des passions ? Les moyens de partir voyager ? Moi après 4 cures de désintox c'est l'amour qui m'a sauvé... Je l'ai connu dans la dernière cure. On s'est marié et j'ai eu 3 enfants, comme quoi. Bon après ça s'est gâté mais j'ai eu de nombreuses années heureuses, crois-moi !
N'hésite pas si tu veux en parler.
Courage à toi !
Un jour à la fois...

- Groschacha
Yogi junky
- 10 novembre 2025 à 09:55
Trop cool que tu écrives un livre, j’ai hâte qu’il soit publié pour pouvoir le lire et te soutenir !
Et oui comme tu dis, il faut absolument trouver d’autres centres d’intérêts ; je voyage beaucoup, j’adore ça, je fais du yoga, j’écris aussi. C’est déjà top d’avoir tout ça :)
Courage à toi aussi,
Amicalement
Alice
Affichage Bureau - A propos de Psychoactif - Politique de confidentialité - CGU - Contact -
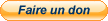 Soutenez PsychoACTIF
Soutenez PsychoACTIF