Menu blogs
Pour ceux qui ont lu les 2 derniers chapitres qui sont écris à la première personne par Rosy (moi
 mais vous l'avez compris) et au présent, est ce que dans un livre vous trouveriez dérangeant de lire ce qui suit (un chapitre relatant les quelques raisons de la dérive de Rosy, donc écrit au passé, qui expliquent au lecteurs pourquoi elle s'accroche à l'H comme à une bouée de sauvetage... ?
mais vous l'avez compris) et au présent, est ce que dans un livre vous trouveriez dérangeant de lire ce qui suit (un chapitre relatant les quelques raisons de la dérive de Rosy, donc écrit au passé, qui expliquent au lecteurs pourquoi elle s'accroche à l'H comme à une bouée de sauvetage... ?Je ne suis pas sûre d'être très claire là... J'ai un peu forcé sur l'Oxy

Place à la lecture...
Chapitre 9
J’étais la troisième enfant d’une fratrie de quatre. Nous vivions dans un foyer où l’amour était présent, mais où on exprimait peu ce qu’on ressentait voir pas du tout. Il y avait beaucoup de pudeur et de non-dits. J’étais une enfant plutôt rigolote, toujours partante pour les bêtises. Je me souviens qu’un jour, j’ai voulu réaliser une cascade de cirque : J’ai posé un tabouret sur une chaise. Je suis montée tout en haut et j’ai sauté. Je me suis cassée la clavicule. Je devais avoir huit ans. Mes parents étaient absents. Ma sœur a appelé la voisine. Je pleurai de douleur, mais aussi de peur que mon père me fiche une bonne raclée. Car oui, mon père avait la main très leste. Il lui arrivait de nous frapper avec des courroies de moteur (il était mécanicien.) juste parce qu’on faisait du bruit pendant sa sieste, ou quand qu'il avait besoin de se défouler.
J’ai très vite compris que je ne rentrais pas dans les cases. Déjà au lycée, bien que brillante, j’étais vraiment prête à participer à tous les mauvais plans. C’était comme ça, c’était en moi. Après avoir obtenu mon baccalauréat, qui m’octroyait la possibilité de travailler en tant que secrétaire médicale, j’ai intégré la faculté Paul Valérie de Montpellier en Sociologie. Pourtant pleine d’ambitions, alors que j’aurai pu me concentrer sur mes études et arriver à mes fins, devenir anthropologue, j’ai choisi de canaliser toute mon énergie sur les soirées étudiante et les mecs. Je fumais des joints tous les jours, je ne dormais pas beaucoup et je m’alimentais très mal.
Lorsque mes parents l’ont appris, juste avant les partielles, ils ne m’ont même pas laissé passer mes examens et sont venus illico me chercher, sans discussion. C’était la fin de mon projet « grandes études ». J’aurai pu me rebeller, mais je n’en ai même pas eu l’idée. Mes parents sont des taiseux, ce qui ne facilite pas les choses. Ils ont aussi une fâcheuse tendance à trop prendre en compte le qu'en dira-t-on… Si on pouvait ne pas faire de vague, c’était mieux.
Après une cohabitation qui m’a paru interminable, j’ai trouvé un emploi de secrétaire médicale dans un centre de radiologie à Osseja tout près de Puigcerda. Le travail était très stressant, car les patients devaient repartir avec leur compte-rendu, que le médecin me dictait, après chaque examen. Autant vous dire que le soir, j’avais besoin de décompresser. Je me suis fait rapidement des amis. La vie était simple et mes parents semblaient soulagés.
Je sortais quasiment tous les soirs, ne serait-ce que pour boire un verre en Espagne ou pour voir des amis dans le seul café situé sur la place du village.
Osseja est un village catalan authentique, blotti à 1200 mètres d’altitude, sur le haut plateau de la Cerdagne. Il offre une vue magnifique sur le massif du Canigou, la montagne sacrée des Catalans. Mais plus qu’un simple village de montagne qui offre un ensoleillement exceptionnel, il est l’endroit où de nombreux établissements de santé se sont implantés depuis plusieurs années : sanatorium, maisons d’enfants, centre de reconversion professionnelle, postcure, etc.
Ces établissements apportaient au village une population particulière, de passage, souhaitant oublier leur quotidien et avec, surtout, beaucoup de temps à tuer. Certains faisaient partie de mon groupe d’amis avec qui nous faisions la fête.
La « Gadzara » était notre fief, c’était un endroit plutôt tranquille où nous pouvions nous amuser et dragouiller, ou se faire dragouiller, innocemment. À l’entrée, se trouvait un homme prénommé, Juan ; une carrure imposante, légèrement bedonnant, environ 45 ans, les cheveux noirs un peu frisés. Il avait une petite moustache touffue et soignée qui lui donnait un petit air de Pablo Escobar. Il était toujours assis sur son tabouret à l’entrée, juste derrière la porte du sas. Il ne bougeait jamais d’un iota.
Cette époque de ma vie était insouciante. Je ne m’en serais jamais lassée si les événements qui allaient suivre ne m’avaient pas obligé à prendre un autre chemin, plus caillouteux, plus accidenté, plus étroit avec un précipice derrière des bas-côtés instables.
Vu mon assiduité dans la boite, nous avons commencé à sympathiser. Il était très tactile et particulièrement avenant. Parfois, je venais près de lui, mon verre en main, et nous discutions de tout et de rien. Il m’a confié un soir avoir un frère qui était en prison pour trafic de drogue. Il m’avait fait voir quelques photos tirées de son portefeuille. Il m’a aussi confié que le patron l’avait embauché parce qu’il avait travaillé à la garda civil. Il me parlait des « affaires » qu’il avait traitées, des anecdotes de sa vie de policier. Petit à petit, il m’a mis en confiance et il est vite devenu un confident.
Ce soir-là, j’étais venu à Puigcerda avec un copain qui était en postcure. Il était chouette, nous nous entendions bien. Il avait une superbe fuego rouge, une bande noire au milieu de son capot, des sièges en moumoutes, bref, un cliché ambulant. Hélas, il avait craqué et av ait commencé par un verre, puis deux… Il a fini allongé sur la banquette complètement ivre. Juan l’a fouillé et lui a pris ses clés. Lorsque la Gadzara a rallumé les lumières en diffusant « le lac du colemara » la fameuse alarme horrible de fin de soirée, mon ami s’est enfin réveillé. Il a appelé le centre et une voiture est venu le récupérer. Juan lui a rendu ses clés.
Je me retrouvais sans chauffeur, seule, à Puigcerda à trois heures de matin. Juan m’a donc proposé naturellement de me raccompagner. À l’époque, je louais une chambre à Osseja au premier étage d’une résidence dans le cœur du village, toute simple : un grand lit, un bureau en bois et deux chaises inconfortables, un lavabo sur pied et un petit coin où je pouvais me préparer à manger. Comme il n’y avait aucune âme dans cette pièce, j’avais accroché quelques posters : le club 32 rivalisait avec Bruce Springsteen, Prince, the cure, Pink Floyd et bien sûr Dire Straits. J’avais aussi tendu des tissus aux motifs un peu bohèmes, un peu hippies. La douche était sur le palier. Une fenêtre devant un minuscule balcon donnait sur la rue, non loin de la place du village.
À notre arrivée à Osseja, Juan m’a demandé s’il pouvait monter boire un café sous prétexte d’une fatigue extrême susceptible de rendre sa conduite dangereuse. Prise de court, je lui ai ouvert ma porte. Il n’y avait aucune ambiguïté de mon côté, je voyais Luis comme une image paternelle, un pilier sur lequel je pouvais m’appuyer. Après avoir bu son café et considérant qu’il n’avait aucun effet sur lui, il m’a demandé si je pouvais lui faire un peu de place pour dormir chez moi. Là encore, bonne pâte, je lui ai dit oui.
Ce n’est qu’une fois couchée que j’ai ressenti un malaise qui montait crescendo. Nous avons arrêté de discuter, et, lumière éteinte, le silence s’est installé, lourd, gênant. Il s’est approché de moi. J’ai d’abord senti ses doigts caresser mon bas-ventre. J’étais tétanisée. Le temps s’était figé. Ce n’était plus moi sous ces draps, dans cette chambre où se heurtaient l’innocence et la prédation. Lorsque ses doigts ont atteint mon intimité, je n’ai pas crié, je n’ai pas hurlé « Non ! », je l’ai laissé faire… Sidérée.
Dans le silence, je n’entendais que le froissement des draps et son souffle rauque, il prenait du plaisir, mais il prenait aussi ce qui ne lui appartenait pas, mon consentement. Mais le plus troublant encore a été cette vague de chaleur qui m’a surprise puis quelques sensations presque agréables, de plus en plus voluptueuses puis, j’ai senti légèrement mes reins se soulever jusqu’au plaisir ultime. La situation était irréelle, mélange de dégout et de culpabilité. Il s’était endormi en cinq minutes, sans dire un mot.
J’ai évité la Gadzara quelques jours, puis les copains ne comprenant pas, nous y sommes retournés, mais je m’arrangeais toujours pour passer la porte accompagnée. Il me saluait naturellement à chacun de mes passages comme si rien ne s’était passé. Je faisais de même. Je me sentais coupable de l’avoir invité à entrer et bien au-delà de ça, coupable d’avoir pris du plaisir dans une situation aussi glauque. Y’avait il un truc clochait chez moi ?
Quelques jours après cette triste nuit, J’entre à la Gadzara avec un groupe d’amis. Au moment de passer à sa hauteur, il s’est levé et m’a empoigné le bras et fait signe au groupe d’avancer. Il m’a attiré vers l’arrière-salle où se trouvait un petit bureau. D’un geste, il m’a soulevé puis assis devant lui, sur une table. J’ai commencé à paniquer, à vouloir me libérer et partir, mais il a élevé la voix et a sorti un pistolet de sa ceinture et me l’a collé sur la tempe.
— Juan… Qu’est-ce que tu fais ?
— Déshabilles toi !
— Quoi ? Mais ça ne va pas ?!
C’était la première fois que je voyais une arme à feu, j’étais terrorisée, je ne comprenais rien de ce qu’il se passait. Je sentais le canon au creux de ma tempe appuyer de plus en plus fort. À ce moment précis, c’est à mes parents que j’ai pensés.
— Allez, dépêches toi !
— Mais non ! Pourquoi ?
— Je veux savoir si tu es une junkie ou pas.
— Quoi ? Mais tu délires là, Juan !
— Non ! Je veux savoir si t’es une indic ! Une putain de junkie indic ! Je veux voir si tu as des traces de piqûres sur le corps ! Mon frère s’est fait tabasser en prison parce que c’était mon frère ! Y a qu’à toi que je l’ai dit Rosy !
Là s’en était trop. J’étais parachuté dans un mauvais film. Je ne voyais pas comment m’en sortir, Juan était furieux, méconnaissable et je me demande même s’il n’y prenait pas un certain plaisir. Il n’était pas question que je me déshabille devant lui. J’ai craqué et je me suis effondrée d’un coup. Je pense que Juan a compris qu’il était allé trop loin et a baissé son arme puis l’a rangé dans l’étui à sa ceinture. La tension est descendue d’un cran.
Il m’a regardé d’un air suspicieux, a inspecté mes deux bras minutieusement puis a juré quelque chose en espagnol. Il m’a fait signe que je pouvais partir et je ne me suis pas fait prier.
J’ai rejoint mes amis qui m’ont demandé pourquoi Juan m’avait retenu. J’ai inventé un bobard pour ne pas remettre de l’huile sur le feu et leur ai proposé d’aller au Club 32.
Pendant quelques semaines, je n’ai pas remis les pieds à Puigcerda. Je ressassais la scène mainte et maintes fois pour essayer de comprendre. Et puis le temps est passé. Et je n’ai plus jamais revu Juan et j’ai appris qu’il avait quitté Puigcerda.
J’ai acquis une capacité à mettre mes problèmes sous le tapis depuis ces deux nuits, je crois. Mon insouciante est revenue et mon envie de faire la fête avec. J’ai fait la connaissance de Salim. Il était en convalescence dans une des maisons de santé de Puigcerda pour les suites d’une tuberculose. Nous nous entendions très bien, nous avions sympathisé lors de soirées avec des amis en commun. C’était un garçon enjoué au physique élancé, plutôt agréable. Tout le monde l’aimait bien. Il avait la qualité de m’avoir trouvée jolie. Un soir, après avoir passé deux heures au café du village à refaire le monde et à boire quelques bières, je rentrais chez moi, fatiguée. La soirée était douce et ma fenêtre était restée entrouverte. Je me mis au lit, lumière éteinte quand j’entends la voix de Salim et de ses deux amis que je venais de quitter au bar.
— Ne déconne pas, Salim ! Tu vas tomber ! Ne fais pas ça ! … Lâcheur !
La fenêtre s’ouvrit dans un léger grincement. Salim venait d’escalader la façade pour monter chez moi. Son audace m’avait désarmée et son regard encore plus. Il a eu droit à un accueil plutôt chaleureux. J’avoue avoir été flatté par tant d’empressement. Et je n’ai même pas protesté.
— Tu sais qu’il y a une sonnette en bas ?
— Nan, par là, c’est plus rapide !
Il s’est approché du lit, m’a pris les mains et a relevé mes bras lentement puis a retiré mon tee-shirt. Il a desserré sa ceinture et d’un geste assuré a fini de se déshabiller sans me quitter des yeux. Puis tout est allé très vite. Nous nous sommes allongés et nos corps se sont apprivoisés.
Tout est devenu rythme, soupirs, frissons. Ses mains expertes ont parcouru mon corps sans que je n’oppose aucune résistance. Je l’ai laissé chercher, trouver et prendre tout ce qu’il a voulu. Je sentais son corps contre le mien, son poids, sa chaleur, cette vague qui montait, qui s’étirait, qui nous emportait. Une seconde suspendue, infinie.
Je l’ai laissé me faire oublier ce qui c’était passé quelques semaines plus tôt, ici même, dans ce lit. Son corps, imparfait, encore convalescent, sa peau dorée et sucré, son visage d’ange, cette nuit-là, m’ont fait chavirer. Il a été mon pansement, désormais, je n’avais plus mal.
Nous ne nous sommes jamais revus. Son séjour arrivait à son terme et il est retourné à Auch, dans sa ville natale. Je n’ai pas eu de peine, enfin, je ne crois pas. Ce n’était pas une surprise, nous en avions déjà parlé avant.
Un truc de plus à mettre sous le tapis. Une fois mon contrat terminé, il était convenu que je revienne chez mes parents en attendant que je trouve du travail. Je me sentais épuisée, et je n’en finissais pas d’avoir sommeil et j’avais aussi quelques nausées. J’ai mis ça sur le compte de mon énième changement de direction dans ma courte vie.
Les nausées ne disparaissant toujours pas, je me suis résolue à faire un test de grossesse. À l’annonce des résultats, qui ont été sans appel, le ciel m’est tombé sur la tête. J’étais enceinte ! Ce fut un vrai cyclone interne… J’allais être maman.
Mais c’était sans compter sur l’autorité qu’exerçait encore ma mère sur moi. Ce qui aurait dû devenir une jolie histoire et vite devenu un cauchemar. Elle avançait des arguments implacables. J’étais trop jeune, trop instable, trop fêtarde, trop drogué, trop immature, trop moi… Ma liberté de penser, voilà tout ce qui me restait. Peut-être était-elle vraiment convaincue que cet enfant n’arriverait pas au monde dans de bonnes conditions ? Qu’elle croyait bien faire ? Que j’étais réellement la dernière des nullités sur la terre ?
Une semaine plus tard, ma mère a tout planifié pour moi, le rendez-vous avec une assistante sociale, le rendez-vous à l’hôpital pour mettre fin à cette grossesse. Elle était aux petits soins, j’étais soudain sa priorité. Jamais je ne l’ai sentie aussi enthousiaste pour une cause, sûrement soulagée que je ne me rebelle pas.
Je ne me souviens plus très bien des mots qu’elle a employé pour que j’accepte l’inacceptable mais la phrase, « c’est mieux pour toi » raisonne dans ma tête. « Mieux pour moi ou pour la réputation de la famille ? » Voilà ce que j’aurai pu répondre. Mais je n’ai pas eu mon mot à dire, je me suis tue et j’ai obéit.
Déjà que j’avais, une piète une opinion de moi, là, c’était l’apothéose. L’idée de contacter Salim m’a traversé l’esprit et puis j’ai renoncé…
Le jour J est arrivé. Ma mère a délégué les opérations à une de mes sœurs de deux ans mon aînée. Elle m’a accompagnée, sûrement pour s’assurer que j’aille au bout du processus. On m’a installé dans une chambre à quatre lits, les avortements s’effectuaient à la chaîne. J’ai tiré les rideaux autour de mon lit, je ne voulais ni parler ni voir personne. Je voulais juste que tout s’arrête.
Nue sous ma blouse, un brancardier était venu me chercher pour me descendre au bloc. Des soignants s’affairaient autour de moi sans même m’adresser la parole ni me regarder. Puis l’anesthésiste m’avait salué avant de m’endormir enfin.
À mon réveil, dans mon lit, entourée de deux autres filles, j’avais une couche énorme entre les cuisses et un tensiomètre accroché au bras et aucune intimité. Je me suis retrouvée seule avec mon ventre vide, vide d’amour, vide d’espoir, vide de vie.
Plusieurs jours après l'intervention, j'ai été prise de maux de ventre terribles. J'habitais chez ma sœur, qui m'avait prise temporairement sous son aile. Elle m’avait trouvé du travail à la Clinique de Prades. J'étais censée commencer à travailler dans la foulée, mais les douleurs devenaient si insupportables que ma sœur, infirmière, a dû me faire lusieurs injections d'antidouleurs dans la nuit. N'obtenant aucune amélioration, j'ai dû me faire hospitaliser pour un second curetage. Je suis donc rentrée à la clinique, non pas en tant qu'employée, mais en tant que patiente. Je me suis vite rétablie physiquement, par contre ce qui était sûr c’est que j'avais désormais une plaie béante en moi qui ne guérirait jamais…
J’ai travaillé à la clinique un an. La surveillante m’avait embauché en tant qu’aide-soignante, mais sur le contrat était écrit : secrétaire Médicale. Au bout d’un an, cette situation ne pouvant pas durer administrativement, elle m’a gentiment remercié. Avec le recul, il est fort possible aussi qu’elle ai repéré ma consommation d’amphétamines et autres douceurs, ça, je ne le saurai jamais.
C’est alors que je me suis retrouvée au centre de rééducation fonctionnelle de Thues les bains…

- Jehol
Psycho junior - 09 octobre 2025 à 17:30
Tjrs un plaisir de te lire.
Je trouve normal d'écrire à l'imparfait pour cette partie de texte antérieur aux autres.
C'est quand même dingue de voir le mal dont est capable l'être humain sur un de ses semblable !
Et après certaines personnes s'étonnent qu'ont se la colle...

- marycora
Nouveau Psycho
- 09 octobre 2025 à 18:14
a écrit
Et après certaines personnes s'étonnent qu'ont se la colle...
Tellement vrai...

- Myozotis
☆ PsychoPote ☆ - 09 octobre 2025 à 20:21
marycora a écrit
La situation était irréelle, mélange de dégout et de culpabilité
Je crois que dans ce genre de situation, notre seule manière de nous protéger de la violence de l'acte, c'est d'y participer.. en analysant ce phénomène je me suis rendue compte que, pour ma part, ça a aussi été une façon de reprendre le contrôle sur l'horreur que je vivais.
Et ce doute persistant. Victime ou complice?
L'errance relationnelle qui s'en est suivie, dans mon cas, a été catastrophique. Destructrice. Et c'est grâce à la consommation de drogue (je suis une touche à tout et à l'époque l'héroïne en faisait grandement partie) que j'ai eu enfin l'impression d'être maîtresse de ma propre vie, pour la toute première fois, c'est pas rien.
Le milieu de la free party m'a aussi énormément aidé à prendre confiance en moi. C'est un ensemble de choses qui font que, malgré les galères et les traumatismes répétés, ben je me kiff. Je suis fière de mon parcours et de la nana que je suis aujourd'hui à 35 ans. Pour certain.es, je crois que c'est le combat d'une vie..
perso grâce à tout ce vécu j'ai l'impression d'avoir pris un train à grande vitesse comparé à des personnes qu'on pourrait qualifier de "lambda".
Alors oui c'est sûr, on me dit "atypique", parfois "folle" (alors que je pense que nous le sommes tous.tes,enfin bref), je ne plaîs pas à tout le monde. Je peux être profondément chiante comme absolument adorable, instable psychologiquement pourtant constante dans mon optimisme général. Parfaitement imparfaite quoi ^^.
Je ne suis pas venue pour me la raconter genre "Je suis trop bonne" lol! Juste que malgré tout ce qu'on peut dire de négatif sur la drogue dans la société ben la réalité est, qu'ils ne se rendent pas compte à quel point cela nourri l'éveil de certaines personnes! Heu ah si c'est ptet ça le problème en fait  .
.
Ce n'est pas parce que je me droguais que je me suis faites violer. Ce n'est par ailleurs jamais le cas, car le viol consiste à dominer de manière jouissive une personne en situation de vulnérabilité. Les scénarios sont donc multiples.
Bref je ne trouve plus les mots mis à part que, pour moi, la honte a enfin changé de camp.
C'est vraiment courageux de ta part de nous partager tout ça Marycora. Ton récit contribue grandement à l'ouverture de la liberté d'expression des femmes, qui est un acquis encore bien mince en 2025. C'est pour cette raison que cela me touche autant. Donc Bravo et surtout Merci.
À +

- marycora
Nouveau Psycho
- 09 octobre 2025 à 20:55

a écrit
Juste que malgré tout ce qu'on peut dire de négatif sur la drogue dans la société ben la réalité est, qu'ils ne se rendent pas compte à quel point cela nourri l'éveil de certaines personnes! Heu ah si c'est ptet ça le problème en fait .
100 % d'accord, oui, ça éveille, ça élève même !
Tu sais, depuis que j'écris mon livre, je ne suis plus la même. Je m'aperçois de trucs vraiment dingues, j'ai vécu tellement de trucs incroyables que c'est presque difficile de les inclure tous dans un seul bouquin sans que le lecteur se dise "Ben elle exagère c'est pas possible" alors que si... C'est possible !
Je me suis posée des questions :
Est ce que je dois édulcorer mon récit ?
Est ce que j'allège pas un peu en laissant des évènements de coté ?
Et puis, j'ai tranché, non, pas du tout.
En fait, plus je me penche sur mes souvenirs, plus j'ai des ouvertures, j'ouvre une porte et derrière y'a encore une autre porte, et encore une autre etc...
Il y a quelques semaines J'ai fouillé une boite à souvenir chez ma mère et là, je me suis pris une autre claque...
Enfin, bref, je me dévoile crûment ça me fait mal, souvent je pleure sur l'enfant (à 19/20 ans on est encore une enfant) que j'étais et qui s'est fait tant de mal.
Et oui, la culpabilité est toujours là, je guérirai peut être un jour... ou pas.

- Myozotis
☆ PsychoPote ☆ - 09 octobre 2025 à 22:22
a écrit
Tu sais, depuis que j'écris mon livre, je ne suis plus la même. Je m'aperçois de trucs vraiment dingues, j'ai vécu tellement de trucs incroyables
Je ne connais pas ton âge exact même si je ne suis pas trop mauvaise en calcul^^. Mais ce que je me disais en te lisant tout à l'heure c'est " le moment idéal dans une vie pour rédiger sa biographie."
À 35 ans je pense qu'il me reste encore beaucoup trop d'étapes avant de pouvoir faire un vrai bilan. Le poser juste lâcher. Donc c'est hyper inspirant de lire ton histoire et c'est aussi d'une certaine façon rassurant.
Ce que je veux dire c'est que les vies intenses sont multiples. Toutes ces parcours que j'ai déjà pu entendre, c'est parfois très difficile à suivre ^^.
La mienne est coriace en son genre aussi mais je sais que je suis tellement loooiiinnn d'être seule !
a écrit
Ben elle exagère c'est pas possible" alors que si... C'est possible !
J'en doute absolument pas !
Quand j'avais 19 ans (justement) mon conjoint de l'époque est mort d'une overdose volontaire aux opiacés et j'ai retrouvé son corps le lendemain. Ce mec avait seulement 23 ans et je n'arrêtais pas de lui dire "mais franchement, tu écris ton histoire, on parie que personne ne te croira".
Et pourtant nous avons tellement besoin de nous confronter à ces chemins de vies même si ils sont parfois difficiles à lire. Ils permettent de penser nos propres trajectoires sous un autre angle (principe de l'art par ailleurs) et j'en suis absolument convaincue.
a écrit
Enfin, bref, je me dévoile crûment ça me fait mal, souvent je pleure sur l'enfant (à 19/20 ans on est encore une enfant) que j'étais et qui s'est fait tant de mal.
Je crois qu'elle a surtout fait du mieux qu'elle pouvait.
a écrit
Et oui, la culpabilité est toujours là, je guérirai peut être un jour... ou pas.
En tout cas tu as fait le premier pas ♡.
Hâte de lire la suite.
À bientôt
Affichage Bureau - A propos de Psychoactif - Politique de confidentialité - CGU - Contact -
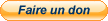 Soutenez PsychoACTIF
Soutenez PsychoACTIF