Menu blogs
Chapitre 11.
Ce serait tellement facile de rejoindre Xavier… L’appareil photo n’est pas loin. Il faut que je le récupère et vite.
La police arrive en force dans l’hôtel, ils s’agitent, certains montent à l’étage quatre à quatre, je ne vois pas pourquoi ils se pressent. Il est mort. C’est fini. Il n’y a plus rien à faire pour lui.
Le patron me désigne d’un signe de tête au policier resté au bar. Il s’approche et me demande de le suivre. C’est un homme posé, qui me parle calmement, peut-être qu’il ne veut pas m’accabler. Il m’amène au poste. Dans la voiture, personne ne parle. De toute façon, je n’ai rien à dire.
On descend du véhicule et l’officier pousse la porte du commissariat et m’invite à entrer. L’atmosphère est austère, presque figée, imprégnée d’une odeur tenace de renfermé et de café. Un néon répand une lumière blafarde sur une rangée de chaises en bois alignées le long du mur.
Devant nous, le policier salue d’un signe de la main son collègue derrière le comptoir de l’accueil. Plusieurs portes identiques s’ouvrent sur de petits bureaux. Nous entrons dans l’un d'eux.
Je me sens de plus en plus mal. Il faut que je me rende à l’évidence et appeler un chat, un chat, je suis en manque. Je ne pense qu’à une chose : récupérer la poudre dans l’appareil photo. Le policier me fait asseoir sur une chaise devant son bureau en métal gris, encombré de paperasse. Ça sent la cigarette.
Il récupère mon sac et ma veste, les fouille avant de s’installer face à moi.
Il me regarde sans sourire, d’un air patient mais distant, comme s’il avait déjà tout vu, tout entendu, mille fois.
— Alors… Nom, prénom ?
Il déplace légèrement le clavier de son ordinateur hors d’âge, grimace légèrement en constatant la lenteur de la connexion et commence à taper avec la vitesse et la grâce d’un lémurien.
— Rosy,
— Rosy comment ?
— Pralet
Je décline ainsi mon identité, mon adresse, les noms de mes parents quand soudain, il tique :
— De Céret ? Vous êtes une des filles de Pralet le Garagiste ?
Surprise, je ne peux qu’acquiescer. Il me regarde alors dans les yeux, sa phrase tombe, tranchante, sans appel :
— Hé ben ! Le pauvre homme ! Je le plains ! Avoir une gosse comme vous ça ne doit pas être simple !
Je ne relève pas. Je baisse les yeux. J’en ai marre. J’en ai tellement marre ! Quand est-ce que je pourrais partir d’ici ? Sortir de ce cauchemar ?
— Le patron du Colorado, qui vous connaît, il m’a dit que vous consommiez de la drogue, comme M. Llorens ? Vous le connaissiez bien ! Vous veniez souvent lui rendre visite à l’hôtel. Pourquoi vous êtes passé le voir ce matin de si bonne heure ? Où vous fournissez-vous ?
M Llorens… L’image de Xavier gisant sur le parquet me revient en tête. Il marque une pause. Une quinte de toux me secoue, violente. Je suis à deux doigts de m’étouffer. Il se lève, revient avec un verre d’eau et me le tend.
— Vous n’êtes pas très en forme, hein ? Vous voulez que j’appelle un médecin ?
— Non… Merci, ça va.
— Peut-on reprendre ?
Je ne lâche aucune information précise. Je tourne autour du pot, j’essaie de l’amadouer, de l’apitoyer, pour qu’il me laisse enfin tranquille. Je n’ai rien fait de répréhensible, mais il m’explique que la situation est suffisamment préoccupante pour qu’il me retienne. Il me menace de me placer en garde à vue.
Rien que l’idée d’être enfermée me donne la nausée. Si je ne me shoote pas bientôt, je serai malade comme un chien. Je lâche donc un peu de lest. Je lui avoue que je consomme de l’héroïne, mais que je compte me soigner. Je pense avoir été assez persuasive, mais il dit d’une voix calme et posée :
— Vous serez convoqué prochainement chez le procureur de la République. Vous recevrez ça par courrier. Vous pouvez récupérer vos affaires. On peut vous ramener en ville si vous voulez ?
Le procureur ? Wow… Là, je ne sais pas trop quoi penser. Le principal, c’est qu’ils me laissent sortir. Je décline sa généreuse proposition, le centre n’est qu’à une dizaine de minutes à pied. Je pousse la porte, je sens le froid s’infiltrer jusqu’à la moelle.
Arrivée en ville, je me dirige vers le Colorado, il faut que je la joue fine. Pas question que quelqu'un me voie rôder autour de l’hôtel. J’emprunte le chemin qui longe le bâtiment et débouche sur la cour arrière, là où se trouve la haie de sapinettes dans laquelle j’ai jeté l’appareil photo.
Je m’avance lentement. Des bruits de vaisselle et de casseroles tintent derrière la porte de service. Je prie pour que personne ne sorte…
Je me baisse et je cherche l’appareil, mais je ne le vois pas. Je finis par ramper littéralement à travers la haie qui longe le mur. Je tâtonne à l’aveugle, les doigts glacés, jusqu’à le toucher enfin ! Un soulagement bref. Je le glisse aussitôt dans mon sac, puis m’éclipse comme je suis venue, le cœur battant pour rejoindre ma voiture.
Je manque de tomber plusieurs fois tant la chaussée est glissante. La neige a déposé une fine pellicule qui a gelé durant la nuit. Ma voiture est blanche. Je n’ai qu’une idée en tête : trouver un endroit où me shooter. Mais je ne peux pas me permettre d’être dérangée, il n’est pas loin de huit heures, il y a de la circulation, trop de regards, trop de risques et le froid est trop vif.
Il faut que je tienne. Que j’attende, encore un peu, je me rends à l’évidence, je le ferai chez moi.
Je gratte grossièrement le pare-brise avec une cassette avant de m’installer au volant, les doigts engourdis. Le moteur tousse avant de démarrer. J’allume le chauffage à fond et attends un peu que la buée disparaisse suffisamment pour partir.
Je roule lentement, les yeux brouillés par les larmes. Mes pensées divaguent entre les événements de la nuit. Tout tourne en boucle dans ma tête, comme un générique de film qui n’en finit jamais.
La route est assez dégagée, le peu de neige tombée a été chassé par les voitures. Autour de moi, le paysage est d’une beauté irréelle, tout en contraste avec la noirceur que j’ai en moi. Au milieu de ce décor parfait, je me sens sale, défaite, à bout de souffle.
Au détour d’un virage, la voiture chasse soudain de l’arrière sur une plaque de verglas. Le volant m’échappe, tout va trop vite. Je pars en tête-à-queue et me retrouve face au sens inverse de la route. Je reste un instant figée, surprise, puis je m’en fiche. Je redresse la voiture et continue la route.
Si j’ai un accident, ce sera bien fait pour moi. L’idée s’installe, tranquille, presque douce. Mourir là, maintenant, sur cette route gelée, mettrait fin à toute mes souffrances. Ce serait comme un juste retour des choses.
Sans que je n’y aie vraiment prêté attention, j’arrive par miracle à Fontpédrouse. Il doit me rester, quelque part, une once d’instinct de survie.
J’entre enfin chez moi. Je repousse gentiment Général du pied, qui réclame un accueil digne de son amour pour moi.
J’enlève rapidement ma veste et la jette sur une chaise. J’entre dans la salle de bains, referme derrière moi.
Mes gestes sont précis, empreints d’un automatisme glaçant. Je prépare tout : la cuillère, le coton, l’eau, la seringue et la poudre.
Je m’assure de moins doser qu’hier soir, enfin, je crois…
Je rejoins le salon, la seringue à la main, j’allume la chaîne et glisse une cassette de Pink Floyd. Je m’assois sur le canapé. Enfin !
Je regarde mon bras, la peau marquée. Je n’hésite pas une seule seconde. J’enfonce l’aiguille, je tire un peu avant de pousser le piston. La chaleur monte, se répand, envahit tout, mon corps, la pièce et bien au-delà.
Je décolle. Les sons se brouillent, la musique s’étire et se distord jusqu’à que je ne reconnaisse même plus le morceau…
Puis l’extase m’envahit complètement et reste en moi. Enfin, pendant quelques heures, tout devient supportable.
Général est collé à moi. Je crois que je le caresse depuis plus d’une heure… Je suis bien. Je ne veux plus jamais être triste, je ne veux plus jamais être moi… Je m’allonge confortablement, la fatigue et la poudre ont raison de moi, je ferme les yeux…
Le téléphone me réveille en sursaut, j’ai du mal à émerger, je me lève enfin, mais la sonnerie s’arrête. Cinq minutes plus tard, il retentit de nouveau. Je décroche.
— Salut, Rosy, c’est moi, c’est Julien !
— Julien…
Sa voix résonne comme un coup de couteau en plein cœur. Tout remonte à la surface d’un coup : l’hôpital, la peur, la mort, Xavier. J’éclate en sanglots, incapable de prononcer le moindre mot. Je ne contrôle plus rien. Mes mains tremblent et je manque d’air.
— Qu’est-ce qui se passe ? Dis-moi, Rosy, s’il te plaît…
L’angoisse m’étrangle. Je m’assois.
— Rosy… Tu es là ?
— Julien… Ça va pas du tout…
— Tu m’inquiètes là… J’arrive ! dit-il d’une voix grave en raccrochant le combiné.
Je reste là, figée, le téléphone à la main. Julien va venir… Je commence à ranger mon matériel, la seringue restée sur la table basse. Je l’essuie grossièrement, fourre le tout au fond d’une trousse que je range dans un tiroir. J’arrange rapidement le plaid sur le canapé et les coussins, comme si ça pouvait effacer ce que je venais de faire…
Je prends une douche chaude, rapide, mais réparatrice. En sortant, mes jambes flanchent. Je me rattrape au lavabo de justesse. Je me redresse, essuie d’un revers de main la buée sur la glace. Mon reflet apparaît : j’ai un teint blafard, des yeux explosés et mes joues commencent à se creuser… Je tire un peu trop sur la corde et ça commence à se voir.
J’enfile une tenue confortable avec un sweat à manches longues, je passe un coup de brosse rapide dans mes cheveux, pour mon visage pas la peine de tenter quoi que ce soit… Avant de sortir de la salle de bains, je me parfume un peu histoire de me sentir bien.
J’entends frapper à la porte. Je vais ouvrir. Aussitôt entré, Julien me prend dans ses bras, me serre très fort sans dire un seul mot. Il desserre son étreinte puis me regarde.
— Tu sens bon…
Son sourire me désarme. Je l’invite à s’asseoir sur le canapé. Il enlève sa veste sans me quitter des yeux un instant.
— Qu’est-ce qui se passe ?
— Je… J’ai déconné…
À nouveau, les sanglots montent et me serrent la gorge. Une nouvelle crise d’angoisse me submerge, plus violente encore que la précédente. Ma respiration s’emballe et mes tremblements reprennent.
Julien assiste à un spectacle navrant ! J’essaie de me calmer.
— Parle-moi… Je peux peut-être t’aider ?
— Tu ne comprends pas, Julien… j’ai fait n’importe quoi…
Julien passe un bras derrière mes épaules et m’attire à lui tendrement. Je me blottis alors contre lui. Je peux sentir sa chaleur et son parfum musqué, doux et agréable. Je commence un peu à m’apaiser.
— N’importe quoi… C’est-à-dire ? reprend-il d’un air soucieux.
Je pense que Julien était à mille lieux de deviner ce qu’il s’est passé réellement cette nuit. Je lui résume mon histoire affligeante. Il m’écoute sans m’interrompre. Par moments, il hoche la tête, comme s’il comprenait, mais je sais qu’il n’en est rien. Comment le pourrait-il ?
Les mots se coincent parfois dans ma gorge, ma voix se fissure. La peur et la tristesse se fondent en une honte immuable, indestructible. J’essaie de dissimuler cette envie viscérale d’en finir avec tout. Quand Julien souffle dans un murmure :
— Je suis content que tu m’aies appelé, je comprends mieux maintenant…
Il resserre son étreinte et continue.
— Il faut que tu sois forte, Rosy, par pitié… Arrête cette merde. Pour Xavier c’est trop tard, mais toi… Tu peux encore t’en sortir.
— Ce n'est pas si simple que ça, tu sais.
— Bien sûr, mais c’est possible. Tu peux venir au chalet quelques jours… Je peux te filer du Valium, j’ai accès à la pharmacie au centre, ça pourrait vraiment t’aider à décrocher ? Pour le reste, faudra du temps…
Un frisson me fait sursauter comme si mon corps rejetait en bloc l’idée de décrocher. Je me redresse un peu et regarde Julien.
— Je ne sais pas trop… Tu veux boire un truc ?
— Rosy…
Je me lève, allume une cigarette et fume devant la fenêtre entrouverte, les yeux dans le vide. Julien me rejoint, il s’assoit sur un tabouret.
— Tu as fait quoi de la came qui restait ?
— Je l’ai jeté.
Je ferme la fenêtre. Je jette le mégot dans le cendrier et me dirige vers le frigidaire. Je mens comme un arracheur de dents, mais je ne pense pas qu’il soit dupe.
— Bière ? dis-je en brandissant 2 bières ambrées à la main pour détourner son attention.
Julien ne se fait pas prier. En prenant la bouteille, il me regarde d’un air suspicieux.
— Tu n’as rien jeté du tout, en fait… Je me trompe ?
— Non…
— Mais Rosy… Tu es convoquée chez le procureur, réveille-toi un peu… Ce n’est pas rien, il faut que tu te soignes.
Je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais plus. Je reste là, la bière à la main, figée. La raison me dit de m’en remettre à Julien, mais l’autre voix me rappelle qu’affronter mes douleurs sans anesthésie est juste insupportable. Julien, à court d’arguments, se lève et s’approche de moi. Il me prend la main et me regarde dans les yeux.
— Je me sens tellement impuissant.
Il me dévisage, un peu perdu. Son pouce effleure ma peau. Je n’ai pas envie de bouger. Son regard s’attarde sur ma bouche, un peu trop longtemps. Puis il se reprend.
— Dis-moi ce que tu attends de moi Rosy. Je suis complètement perdu.
Tout en lui respire la patience, la tendresse. Il attend plus de moi que ce que je peux lui donner. Je sens que je le blesse, mais je n’ai pas la force d’aimer vraiment. Je pourrai l’embrasser, là, maintenant et d’ici deux heures le détester parce que je ne me supporte plus moi-même.
— J’ai juste besoin d’un ami Julien…
— On ne regarde pas un ami comme tu le fais en ce moment… Tu vas finir par me rendre fou, murmure-t-il
Son bras glisse derrière mon dos et m’attire à lui. Ses yeux m’implorent. Je cède. Nos souffles se mêlent, tout près, nos bouches s’effleurent, sa main derrière ma nuque m’invite alors à un baiser plus profond, plus intense. Julien me regarde, visiblement troublé.
— Tout pourrait être si simple… Tu ne crois pas ?
— J’aimerais tant, je ne demande que ça…
Il prend ma main et m’attire vers le canapé. En passant, il jette un œil sur la corbeille près de la chaîne stéréo.
. — On peut mettre un peu de musique ?
— Bien sûr, vas-y, fouille.
— Tu as des petites pépites là-dedans, voyons.
— Sade, ça t’irait ?
— Parfait.
Il s’assoit près de moi et m’enlace comme le feraient deux amants. Je ne me fais pas prier et je me love dans ses bras, la tête sur sa poitrine, les jambes repliées.
— Voilà ce que j’attends de toi, je crois… Une épaule sur qui compter et une oreille à qui parler, et Dieu sait que j’en ai besoin aujourd’hui.
— Je vais m’en contenter alors.
Je relève la tête, il me sourit.
— Fais attention, si tu continues à me regarder comme ça, je vais devoir sortir prendre l’air !
Je ris de bon cœur. Un vrai rire, ni forcé, ni nerveux. Julien éclate de rire aussi, et pendant quelques secondes, tout s’allège. Comme si l’horreur de ces dernières heures s’était dissipée, balayée par ce moment simple, anecdotique.
— Voilà, ça me fait plaisir de te voir sourire. C’est bien pour ça que j’aimerais que tu viennes quelques jours au chalet. Ça serait bien plus facile avec moi.
— Non, j’ai pris ma décision, je vais tenter d’arrêter, mais ici, chez moi. Tu sais, ça ne va pas être drôle du tout et je n’ai vraiment pas envie de t’imposer cette version de moi.
— Ça sera encore plus dur toute seule…
— Peut-être oui, mais je veux garder ce qu’il me reste de dignité… Je suis sûre que tu peux comprendre.
Julien n’insiste pas. Il commence à me connaître. Je suis très têtue. Je reste blottie dans ses bras, plus d’une heure. Nous discutons de tout, de rien, il me raconte quelques anecdotes qu’il a vécues durant ses années d’études de kiné, il me parle de sa famille, de ses amis. Tant de choses qui me font oublier, pour un instant, cette horrible nuit. Julien dépose un baiser sur mon front puis relâche son étreinte. Je me redresse.
— Je vais récupérer un peu de Valium au centre, avant qu’il soit trop tard. Est-ce que tu as besoin de quelque chose d’autre ?
— Non, je ne crois pas.
— Tu m’attends sagement, ok ? dit-il en enfilant sa veste.
Je lui fais signe de la tête et l’accompagne jusqu’à la rue. La nuit commence à tomber. Le peu de neige tombée a fondu. La voiture de Julien s’éloigne. J’en profite pour relever mon courrier. J’ai froid. Je remonte vite à l’appartement.
— C’est bon Général, je vais m’occuper un peu de toi…
Je m’acquitte de mes tâches de maîtresse parfaite, il a désormais une litière qui sent bon, des gamelles nettoyées et garnies, et après un gros câlin, il part se remettre de ses émotions sur son plaid près du radiateur.
Je cale la chaîne sur radio 7 car le silence m’oppresse.
J’ouvre mon courrier qui s’est un peu accumulé, depuis quelque temps, j’ai tendance à procrastiner. Une lettre attire mon attention. Sofinco ? J’ouvre vite… Un prêt m’a été accordé sous forme de réserve de 30 000 francs. Je n’en reviens pas. Wow…
Je fais bouillir un peu d’eau pour faire une infusion quand j’entends Julien arriver. Je fais disparaître le courrier en le déposant dans un tiroir.
— Pousse la porte, c’est ouvert… Alors, tu n'as pas eu de problème ?
— Non, du tout, dit-il en enlevant sa veste et en retirant un petit paquet de sa poche. Tiens, je ne t’en donne que quatre, tu les espaces de six heures… Je devrais rester avec toi ce week-end.
— On en a déjà parlé, Julien.
— Et Cathy ? Tu pourrais l’appeler ?
— Je ne crois pas. Je pense qu’elle m’en veut beaucoup.
— Au fait, Valérie m’a dit qu'un homme t’avait demandé au téléphone hier. Il n’a pas voulu laisser de message.
J’ai beau chercher, je ne vois pas qui aurait pu m’appeler au centre. Cela ne me préoccupe pas plus que ça. J’en saurais plus lundi.
— Je préfère que tu partes maintenant, le ciel est bas, je crains qu’il neige bientôt…
— Alors avec un peu de chance, je serai coincé ici si j’attends un peu…
— Julien…
Il sourit, s’approche, prend ma tête entre ses mains :
— J’aimerais tant savoir ce qu’il y a dans cette jolie caboche.
Il met son manteau, me prend dans ses bras et dépose un baiser sur mes lèvres.
— Tu prends bien soin de toi, Rosy, tu me le promets ?
— Oui, merci pour tout, tu es adorable.
— Que veux-tu ? Mon bon cœur me perdra, répond-t-il en souriant.
J’entends ses pas dans l’escalier, puis le claquement sec de la porte d’en bas. Quand tout redevient silencieux. Je reste là un moment, hébétée, Julien me manque déjà.
Suis-je prête à entamer cet horrible voyage qui me mènera à une vie sans héroïne ? J’allume une cigarette. L’image de Xavier passe et repasse en boucle dans ma tête. Je n’ai envie de rien. Il n’est pas loin de vingt et une heures et je n’ai rien mangé depuis ce matin.
Je me prépare un plateau : un sandwich au jambon avec du pain de mie et un peu de fromage, un yaourt et un grand verre d’eau. J’allume la télé, histoire de me changer les idées.
Michel Drucker reçoit Johny Hallyday, pour son album Rock n Roll Attitude, il a vraiment de très beaux yeux ce gars-là. À côté de lui, France Gall, un tout petit bout de femme, sourit timidement. Daniel Balavoine fait sa promo de son dernier album « Sauver l’amour ». Il y a aussi Coluche. J’adore son franc-parler. Il lance une association « les Restos du Cœur » — pour que plus personne ne crève de faim cet hiver — dit-il. C’est quand même dingue, cette époque : il faut qu’un humoriste se lève pour venir en aide aux plus démunis pendant que l’État regarde ailleurs. Pendant que les politiques parlent de croissance, certains fouillent les poubelles. Je fixe l’écran en caressant Général.
Tout ça me saoule, je termine mon plateau puis j’éteins la télé.
J’allume une cigarette, puis je pars chercher le livre que Cathy m’a offert pour mon anniversaire. Autant essayer de lire… « 37°2 le matin ». Voyons si Philippe Djian peut m’aider à penser à autre chose qu’à la came.
Je me prépare pour aller dormir : je me brosse les dents, enfile mon pyjama en flanelle, chaud et doux comme une caresse. Je glisse sous la couette, j’ouvre le livre et j’essaie de me concentrer.
Les lignes se brouillent déjà. Je bâille tellement que mes yeux s’emplissent de larmes. Malgré mes efforts, je suis incapable de suivre le fil. Au bout d’un chapitre, je referme le livre. Général me rejoint, j’éteins la lumière. Je m’abandonne.
Je me réveille en sursaut. Je suis en nage. Une odeur désagréable de tabac froid mélangé à de la sueur me prend à la gorge et me donne la nausée. Les draps sont trempés. J’ai très froid, je tremble et je claque des dents, c’est horrible. Des douleurs dans les reins et tous les os de mon corps deviennent vite insupportables.
Je me lève. Le pyjama me colle à la peau, trempé, mais comment ai-je pu transpirer autant ? Je m’assois sur le bord du lit et me couvre les épaules avec un plaid. J’ai mal, je n’en peux plus. Je craque. Les sanglots montent, brutaux, incontrôlables. J’étais pourtant prête à endurer cette épreuve, il y a encore quelques heures, mais là, c’en est trop.
Je me rue dans la salle de bains. Je me déshabille et allume l’eau chaude de la douche. Je me réchauffe doucement, mais mes dents continuent de claquer. J’enveloppe mon corps endolori dans mon peignoir. Le miroir me renvoie une image peu glorieuse : des lèvres pâles, un teint livide.
Je change les draps avec une grande difficulté, la couette me paraît peser une tonne et soulever le matelas est une épreuve. J’ai de plus en plus froid. Je ne tiens plus. Le Valium attendra. Je pense à Julien… j’aimerais tenir, mais tout mon corps hurle le contraire.
Puis l’image de Xavier, s’impose, brutale, comme une gifle. Je ferme les yeux. Il faut que ça s’arrête. Tout de suite.
Je choisis.
Je ne réfléchis plus.
Je récupère le matériel, la poudre.
Je me concentre au maximum pour ne pas trop trembler et prépare mon mélange.
Au creux de mon ventre, cette même fièvre qu’avant un baiser ou une étreinte, ment à s’y méprendre.
Je m’installe dans le lit, je serre le garrot avant de piquer puis je m’en libère. L’aiguille…
Le soulagement…
La chaleur monte le long de mes veines.
Je ferme les yeux, les tremblements cessent, les larmes aussi, tout s’éloigne doucement…
Ce serait tellement facile de rejoindre Xavier… L’appareil photo n’est pas loin. Il faut que je le récupère et vite.
La police arrive en force dans l’hôtel, ils s’agitent, certains montent à l’étage quatre à quatre, je ne vois pas pourquoi ils se pressent. Il est mort. C’est fini. Il n’y a plus rien à faire pour lui.
Le patron me désigne d’un signe de tête au policier resté au bar. Il s’approche et me demande de le suivre. C’est un homme posé, qui me parle calmement, peut-être qu’il ne veut pas m’accabler. Il m’amène au poste. Dans la voiture, personne ne parle. De toute façon, je n’ai rien à dire.
On descend du véhicule et l’officier pousse la porte du commissariat et m’invite à entrer. L’atmosphère est austère, presque figée, imprégnée d’une odeur tenace de renfermé et de café. Un néon répand une lumière blafarde sur une rangée de chaises en bois alignées le long du mur.
Devant nous, le policier salue d’un signe de la main son collègue derrière le comptoir de l’accueil. Plusieurs portes identiques s’ouvrent sur de petits bureaux. Nous entrons dans l’un d'eux.
Je me sens de plus en plus mal. Il faut que je me rende à l’évidence et appeler un chat, un chat, je suis en manque. Je ne pense qu’à une chose : récupérer la poudre dans l’appareil photo. Le policier me fait asseoir sur une chaise devant son bureau en métal gris, encombré de paperasse. Ça sent la cigarette.
Il récupère mon sac et ma veste, les fouille avant de s’installer face à moi.
Il me regarde sans sourire, d’un air patient mais distant, comme s’il avait déjà tout vu, tout entendu, mille fois.
— Alors… Nom, prénom ?
Il déplace légèrement le clavier de son ordinateur hors d’âge, grimace légèrement en constatant la lenteur de la connexion et commence à taper avec la vitesse et la grâce d’un lémurien.
— Rosy,
— Rosy comment ?
— Pralet
Je décline ainsi mon identité, mon adresse, les noms de mes parents quand soudain, il tique :
— De Céret ? Vous êtes une des filles de Pralet le Garagiste ?
Surprise, je ne peux qu’acquiescer. Il me regarde alors dans les yeux, sa phrase tombe, tranchante, sans appel :
— Hé ben ! Le pauvre homme ! Je le plains ! Avoir une gosse comme vous ça ne doit pas être simple !
Je ne relève pas. Je baisse les yeux. J’en ai marre. J’en ai tellement marre ! Quand est-ce que je pourrais partir d’ici ? Sortir de ce cauchemar ?
— Le patron du Colorado, qui vous connaît, il m’a dit que vous consommiez de la drogue, comme M. Llorens ? Vous le connaissiez bien ! Vous veniez souvent lui rendre visite à l’hôtel. Pourquoi vous êtes passé le voir ce matin de si bonne heure ? Où vous fournissez-vous ?
M Llorens… L’image de Xavier gisant sur le parquet me revient en tête. Il marque une pause. Une quinte de toux me secoue, violente. Je suis à deux doigts de m’étouffer. Il se lève, revient avec un verre d’eau et me le tend.
— Vous n’êtes pas très en forme, hein ? Vous voulez que j’appelle un médecin ?
— Non… Merci, ça va.
— Peut-on reprendre ?
Je ne lâche aucune information précise. Je tourne autour du pot, j’essaie de l’amadouer, de l’apitoyer, pour qu’il me laisse enfin tranquille. Je n’ai rien fait de répréhensible, mais il m’explique que la situation est suffisamment préoccupante pour qu’il me retienne. Il me menace de me placer en garde à vue.
Rien que l’idée d’être enfermée me donne la nausée. Si je ne me shoote pas bientôt, je serai malade comme un chien. Je lâche donc un peu de lest. Je lui avoue que je consomme de l’héroïne, mais que je compte me soigner. Je pense avoir été assez persuasive, mais il dit d’une voix calme et posée :
— Vous serez convoqué prochainement chez le procureur de la République. Vous recevrez ça par courrier. Vous pouvez récupérer vos affaires. On peut vous ramener en ville si vous voulez ?
Le procureur ? Wow… Là, je ne sais pas trop quoi penser. Le principal, c’est qu’ils me laissent sortir. Je décline sa généreuse proposition, le centre n’est qu’à une dizaine de minutes à pied. Je pousse la porte, je sens le froid s’infiltrer jusqu’à la moelle.
Arrivée en ville, je me dirige vers le Colorado, il faut que je la joue fine. Pas question que quelqu'un me voie rôder autour de l’hôtel. J’emprunte le chemin qui longe le bâtiment et débouche sur la cour arrière, là où se trouve la haie de sapinettes dans laquelle j’ai jeté l’appareil photo.
Je m’avance lentement. Des bruits de vaisselle et de casseroles tintent derrière la porte de service. Je prie pour que personne ne sorte…
Je me baisse et je cherche l’appareil, mais je ne le vois pas. Je finis par ramper littéralement à travers la haie qui longe le mur. Je tâtonne à l’aveugle, les doigts glacés, jusqu’à le toucher enfin ! Un soulagement bref. Je le glisse aussitôt dans mon sac, puis m’éclipse comme je suis venue, le cœur battant pour rejoindre ma voiture.
Je manque de tomber plusieurs fois tant la chaussée est glissante. La neige a déposé une fine pellicule qui a gelé durant la nuit. Ma voiture est blanche. Je n’ai qu’une idée en tête : trouver un endroit où me shooter. Mais je ne peux pas me permettre d’être dérangée, il n’est pas loin de huit heures, il y a de la circulation, trop de regards, trop de risques et le froid est trop vif.
Il faut que je tienne. Que j’attende, encore un peu, je me rends à l’évidence, je le ferai chez moi.
Je gratte grossièrement le pare-brise avec une cassette avant de m’installer au volant, les doigts engourdis. Le moteur tousse avant de démarrer. J’allume le chauffage à fond et attends un peu que la buée disparaisse suffisamment pour partir.
Je roule lentement, les yeux brouillés par les larmes. Mes pensées divaguent entre les événements de la nuit. Tout tourne en boucle dans ma tête, comme un générique de film qui n’en finit jamais.
La route est assez dégagée, le peu de neige tombée a été chassé par les voitures. Autour de moi, le paysage est d’une beauté irréelle, tout en contraste avec la noirceur que j’ai en moi. Au milieu de ce décor parfait, je me sens sale, défaite, à bout de souffle.
Au détour d’un virage, la voiture chasse soudain de l’arrière sur une plaque de verglas. Le volant m’échappe, tout va trop vite. Je pars en tête-à-queue et me retrouve face au sens inverse de la route. Je reste un instant figée, surprise, puis je m’en fiche. Je redresse la voiture et continue la route.
Si j’ai un accident, ce sera bien fait pour moi. L’idée s’installe, tranquille, presque douce. Mourir là, maintenant, sur cette route gelée, mettrait fin à toute mes souffrances. Ce serait comme un juste retour des choses.
Sans que je n’y aie vraiment prêté attention, j’arrive par miracle à Fontpédrouse. Il doit me rester, quelque part, une once d’instinct de survie.
J’entre enfin chez moi. Je repousse gentiment Général du pied, qui réclame un accueil digne de son amour pour moi.
J’enlève rapidement ma veste et la jette sur une chaise. J’entre dans la salle de bains, referme derrière moi.
Mes gestes sont précis, empreints d’un automatisme glaçant. Je prépare tout : la cuillère, le coton, l’eau, la seringue et la poudre.
Je m’assure de moins doser qu’hier soir, enfin, je crois…
Je rejoins le salon, la seringue à la main, j’allume la chaîne et glisse une cassette de Pink Floyd. Je m’assois sur le canapé. Enfin !
Je regarde mon bras, la peau marquée. Je n’hésite pas une seule seconde. J’enfonce l’aiguille, je tire un peu avant de pousser le piston. La chaleur monte, se répand, envahit tout, mon corps, la pièce et bien au-delà.
Je décolle. Les sons se brouillent, la musique s’étire et se distord jusqu’à que je ne reconnaisse même plus le morceau…
Puis l’extase m’envahit complètement et reste en moi. Enfin, pendant quelques heures, tout devient supportable.
Général est collé à moi. Je crois que je le caresse depuis plus d’une heure… Je suis bien. Je ne veux plus jamais être triste, je ne veux plus jamais être moi… Je m’allonge confortablement, la fatigue et la poudre ont raison de moi, je ferme les yeux…
Le téléphone me réveille en sursaut, j’ai du mal à émerger, je me lève enfin, mais la sonnerie s’arrête. Cinq minutes plus tard, il retentit de nouveau. Je décroche.
— Salut, Rosy, c’est moi, c’est Julien !
— Julien…
Sa voix résonne comme un coup de couteau en plein cœur. Tout remonte à la surface d’un coup : l’hôpital, la peur, la mort, Xavier. J’éclate en sanglots, incapable de prononcer le moindre mot. Je ne contrôle plus rien. Mes mains tremblent et je manque d’air.
— Qu’est-ce qui se passe ? Dis-moi, Rosy, s’il te plaît…
L’angoisse m’étrangle. Je m’assois.
— Rosy… Tu es là ?
— Julien… Ça va pas du tout…
— Tu m’inquiètes là… J’arrive ! dit-il d’une voix grave en raccrochant le combiné.
Je reste là, figée, le téléphone à la main. Julien va venir… Je commence à ranger mon matériel, la seringue restée sur la table basse. Je l’essuie grossièrement, fourre le tout au fond d’une trousse que je range dans un tiroir. J’arrange rapidement le plaid sur le canapé et les coussins, comme si ça pouvait effacer ce que je venais de faire…
Je prends une douche chaude, rapide, mais réparatrice. En sortant, mes jambes flanchent. Je me rattrape au lavabo de justesse. Je me redresse, essuie d’un revers de main la buée sur la glace. Mon reflet apparaît : j’ai un teint blafard, des yeux explosés et mes joues commencent à se creuser… Je tire un peu trop sur la corde et ça commence à se voir.
J’enfile une tenue confortable avec un sweat à manches longues, je passe un coup de brosse rapide dans mes cheveux, pour mon visage pas la peine de tenter quoi que ce soit… Avant de sortir de la salle de bains, je me parfume un peu histoire de me sentir bien.
J’entends frapper à la porte. Je vais ouvrir. Aussitôt entré, Julien me prend dans ses bras, me serre très fort sans dire un seul mot. Il desserre son étreinte puis me regarde.
— Tu sens bon…
Son sourire me désarme. Je l’invite à s’asseoir sur le canapé. Il enlève sa veste sans me quitter des yeux un instant.
— Qu’est-ce qui se passe ?
— Je… J’ai déconné…
À nouveau, les sanglots montent et me serrent la gorge. Une nouvelle crise d’angoisse me submerge, plus violente encore que la précédente. Ma respiration s’emballe et mes tremblements reprennent.
Julien assiste à un spectacle navrant ! J’essaie de me calmer.
— Parle-moi… Je peux peut-être t’aider ?
— Tu ne comprends pas, Julien… j’ai fait n’importe quoi…
Julien passe un bras derrière mes épaules et m’attire à lui tendrement. Je me blottis alors contre lui. Je peux sentir sa chaleur et son parfum musqué, doux et agréable. Je commence un peu à m’apaiser.
— N’importe quoi… C’est-à-dire ? reprend-il d’un air soucieux.
Je pense que Julien était à mille lieux de deviner ce qu’il s’est passé réellement cette nuit. Je lui résume mon histoire affligeante. Il m’écoute sans m’interrompre. Par moments, il hoche la tête, comme s’il comprenait, mais je sais qu’il n’en est rien. Comment le pourrait-il ?
Les mots se coincent parfois dans ma gorge, ma voix se fissure. La peur et la tristesse se fondent en une honte immuable, indestructible. J’essaie de dissimuler cette envie viscérale d’en finir avec tout. Quand Julien souffle dans un murmure :
— Je suis content que tu m’aies appelé, je comprends mieux maintenant…
Il resserre son étreinte et continue.
— Il faut que tu sois forte, Rosy, par pitié… Arrête cette merde. Pour Xavier c’est trop tard, mais toi… Tu peux encore t’en sortir.
— Ce n'est pas si simple que ça, tu sais.
— Bien sûr, mais c’est possible. Tu peux venir au chalet quelques jours… Je peux te filer du Valium, j’ai accès à la pharmacie au centre, ça pourrait vraiment t’aider à décrocher ? Pour le reste, faudra du temps…
Un frisson me fait sursauter comme si mon corps rejetait en bloc l’idée de décrocher. Je me redresse un peu et regarde Julien.
— Je ne sais pas trop… Tu veux boire un truc ?
— Rosy…
Je me lève, allume une cigarette et fume devant la fenêtre entrouverte, les yeux dans le vide. Julien me rejoint, il s’assoit sur un tabouret.
— Tu as fait quoi de la came qui restait ?
— Je l’ai jeté.
Je ferme la fenêtre. Je jette le mégot dans le cendrier et me dirige vers le frigidaire. Je mens comme un arracheur de dents, mais je ne pense pas qu’il soit dupe.
— Bière ? dis-je en brandissant 2 bières ambrées à la main pour détourner son attention.
Julien ne se fait pas prier. En prenant la bouteille, il me regarde d’un air suspicieux.
— Tu n’as rien jeté du tout, en fait… Je me trompe ?
— Non…
— Mais Rosy… Tu es convoquée chez le procureur, réveille-toi un peu… Ce n’est pas rien, il faut que tu te soignes.
Je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais plus. Je reste là, la bière à la main, figée. La raison me dit de m’en remettre à Julien, mais l’autre voix me rappelle qu’affronter mes douleurs sans anesthésie est juste insupportable. Julien, à court d’arguments, se lève et s’approche de moi. Il me prend la main et me regarde dans les yeux.
— Je me sens tellement impuissant.
Il me dévisage, un peu perdu. Son pouce effleure ma peau. Je n’ai pas envie de bouger. Son regard s’attarde sur ma bouche, un peu trop longtemps. Puis il se reprend.
— Dis-moi ce que tu attends de moi Rosy. Je suis complètement perdu.
Tout en lui respire la patience, la tendresse. Il attend plus de moi que ce que je peux lui donner. Je sens que je le blesse, mais je n’ai pas la force d’aimer vraiment. Je pourrai l’embrasser, là, maintenant et d’ici deux heures le détester parce que je ne me supporte plus moi-même.
— J’ai juste besoin d’un ami Julien…
— On ne regarde pas un ami comme tu le fais en ce moment… Tu vas finir par me rendre fou, murmure-t-il
Son bras glisse derrière mon dos et m’attire à lui. Ses yeux m’implorent. Je cède. Nos souffles se mêlent, tout près, nos bouches s’effleurent, sa main derrière ma nuque m’invite alors à un baiser plus profond, plus intense. Julien me regarde, visiblement troublé.
— Tout pourrait être si simple… Tu ne crois pas ?
— J’aimerais tant, je ne demande que ça…
Il prend ma main et m’attire vers le canapé. En passant, il jette un œil sur la corbeille près de la chaîne stéréo.
. — On peut mettre un peu de musique ?
— Bien sûr, vas-y, fouille.
— Tu as des petites pépites là-dedans, voyons.
— Sade, ça t’irait ?
— Parfait.
Il s’assoit près de moi et m’enlace comme le feraient deux amants. Je ne me fais pas prier et je me love dans ses bras, la tête sur sa poitrine, les jambes repliées.
— Voilà ce que j’attends de toi, je crois… Une épaule sur qui compter et une oreille à qui parler, et Dieu sait que j’en ai besoin aujourd’hui.
— Je vais m’en contenter alors.
Je relève la tête, il me sourit.
— Fais attention, si tu continues à me regarder comme ça, je vais devoir sortir prendre l’air !
Je ris de bon cœur. Un vrai rire, ni forcé, ni nerveux. Julien éclate de rire aussi, et pendant quelques secondes, tout s’allège. Comme si l’horreur de ces dernières heures s’était dissipée, balayée par ce moment simple, anecdotique.
— Voilà, ça me fait plaisir de te voir sourire. C’est bien pour ça que j’aimerais que tu viennes quelques jours au chalet. Ça serait bien plus facile avec moi.
— Non, j’ai pris ma décision, je vais tenter d’arrêter, mais ici, chez moi. Tu sais, ça ne va pas être drôle du tout et je n’ai vraiment pas envie de t’imposer cette version de moi.
— Ça sera encore plus dur toute seule…
— Peut-être oui, mais je veux garder ce qu’il me reste de dignité… Je suis sûre que tu peux comprendre.
Julien n’insiste pas. Il commence à me connaître. Je suis très têtue. Je reste blottie dans ses bras, plus d’une heure. Nous discutons de tout, de rien, il me raconte quelques anecdotes qu’il a vécues durant ses années d’études de kiné, il me parle de sa famille, de ses amis. Tant de choses qui me font oublier, pour un instant, cette horrible nuit. Julien dépose un baiser sur mon front puis relâche son étreinte. Je me redresse.
— Je vais récupérer un peu de Valium au centre, avant qu’il soit trop tard. Est-ce que tu as besoin de quelque chose d’autre ?
— Non, je ne crois pas.
— Tu m’attends sagement, ok ? dit-il en enfilant sa veste.
Je lui fais signe de la tête et l’accompagne jusqu’à la rue. La nuit commence à tomber. Le peu de neige tombée a fondu. La voiture de Julien s’éloigne. J’en profite pour relever mon courrier. J’ai froid. Je remonte vite à l’appartement.
— C’est bon Général, je vais m’occuper un peu de toi…
Je m’acquitte de mes tâches de maîtresse parfaite, il a désormais une litière qui sent bon, des gamelles nettoyées et garnies, et après un gros câlin, il part se remettre de ses émotions sur son plaid près du radiateur.
Je cale la chaîne sur radio 7 car le silence m’oppresse.
J’ouvre mon courrier qui s’est un peu accumulé, depuis quelque temps, j’ai tendance à procrastiner. Une lettre attire mon attention. Sofinco ? J’ouvre vite… Un prêt m’a été accordé sous forme de réserve de 30 000 francs. Je n’en reviens pas. Wow…
Je fais bouillir un peu d’eau pour faire une infusion quand j’entends Julien arriver. Je fais disparaître le courrier en le déposant dans un tiroir.
— Pousse la porte, c’est ouvert… Alors, tu n'as pas eu de problème ?
— Non, du tout, dit-il en enlevant sa veste et en retirant un petit paquet de sa poche. Tiens, je ne t’en donne que quatre, tu les espaces de six heures… Je devrais rester avec toi ce week-end.
— On en a déjà parlé, Julien.
— Et Cathy ? Tu pourrais l’appeler ?
— Je ne crois pas. Je pense qu’elle m’en veut beaucoup.
— Au fait, Valérie m’a dit qu'un homme t’avait demandé au téléphone hier. Il n’a pas voulu laisser de message.
J’ai beau chercher, je ne vois pas qui aurait pu m’appeler au centre. Cela ne me préoccupe pas plus que ça. J’en saurais plus lundi.
— Je préfère que tu partes maintenant, le ciel est bas, je crains qu’il neige bientôt…
— Alors avec un peu de chance, je serai coincé ici si j’attends un peu…
— Julien…
Il sourit, s’approche, prend ma tête entre ses mains :
— J’aimerais tant savoir ce qu’il y a dans cette jolie caboche.
Il met son manteau, me prend dans ses bras et dépose un baiser sur mes lèvres.
— Tu prends bien soin de toi, Rosy, tu me le promets ?
— Oui, merci pour tout, tu es adorable.
— Que veux-tu ? Mon bon cœur me perdra, répond-t-il en souriant.
J’entends ses pas dans l’escalier, puis le claquement sec de la porte d’en bas. Quand tout redevient silencieux. Je reste là un moment, hébétée, Julien me manque déjà.
Suis-je prête à entamer cet horrible voyage qui me mènera à une vie sans héroïne ? J’allume une cigarette. L’image de Xavier passe et repasse en boucle dans ma tête. Je n’ai envie de rien. Il n’est pas loin de vingt et une heures et je n’ai rien mangé depuis ce matin.
Je me prépare un plateau : un sandwich au jambon avec du pain de mie et un peu de fromage, un yaourt et un grand verre d’eau. J’allume la télé, histoire de me changer les idées.
Michel Drucker reçoit Johny Hallyday, pour son album Rock n Roll Attitude, il a vraiment de très beaux yeux ce gars-là. À côté de lui, France Gall, un tout petit bout de femme, sourit timidement. Daniel Balavoine fait sa promo de son dernier album « Sauver l’amour ». Il y a aussi Coluche. J’adore son franc-parler. Il lance une association « les Restos du Cœur » — pour que plus personne ne crève de faim cet hiver — dit-il. C’est quand même dingue, cette époque : il faut qu’un humoriste se lève pour venir en aide aux plus démunis pendant que l’État regarde ailleurs. Pendant que les politiques parlent de croissance, certains fouillent les poubelles. Je fixe l’écran en caressant Général.
Tout ça me saoule, je termine mon plateau puis j’éteins la télé.
J’allume une cigarette, puis je pars chercher le livre que Cathy m’a offert pour mon anniversaire. Autant essayer de lire… « 37°2 le matin ». Voyons si Philippe Djian peut m’aider à penser à autre chose qu’à la came.
Je me prépare pour aller dormir : je me brosse les dents, enfile mon pyjama en flanelle, chaud et doux comme une caresse. Je glisse sous la couette, j’ouvre le livre et j’essaie de me concentrer.
Les lignes se brouillent déjà. Je bâille tellement que mes yeux s’emplissent de larmes. Malgré mes efforts, je suis incapable de suivre le fil. Au bout d’un chapitre, je referme le livre. Général me rejoint, j’éteins la lumière. Je m’abandonne.
Je me réveille en sursaut. Je suis en nage. Une odeur désagréable de tabac froid mélangé à de la sueur me prend à la gorge et me donne la nausée. Les draps sont trempés. J’ai très froid, je tremble et je claque des dents, c’est horrible. Des douleurs dans les reins et tous les os de mon corps deviennent vite insupportables.
Je me lève. Le pyjama me colle à la peau, trempé, mais comment ai-je pu transpirer autant ? Je m’assois sur le bord du lit et me couvre les épaules avec un plaid. J’ai mal, je n’en peux plus. Je craque. Les sanglots montent, brutaux, incontrôlables. J’étais pourtant prête à endurer cette épreuve, il y a encore quelques heures, mais là, c’en est trop.
Je me rue dans la salle de bains. Je me déshabille et allume l’eau chaude de la douche. Je me réchauffe doucement, mais mes dents continuent de claquer. J’enveloppe mon corps endolori dans mon peignoir. Le miroir me renvoie une image peu glorieuse : des lèvres pâles, un teint livide.
Je change les draps avec une grande difficulté, la couette me paraît peser une tonne et soulever le matelas est une épreuve. J’ai de plus en plus froid. Je ne tiens plus. Le Valium attendra. Je pense à Julien… j’aimerais tenir, mais tout mon corps hurle le contraire.
Puis l’image de Xavier, s’impose, brutale, comme une gifle. Je ferme les yeux. Il faut que ça s’arrête. Tout de suite.
Je choisis.
Je ne réfléchis plus.
Je récupère le matériel, la poudre.
Je me concentre au maximum pour ne pas trop trembler et prépare mon mélange.
Au creux de mon ventre, cette même fièvre qu’avant un baiser ou une étreinte, ment à s’y méprendre.
Je m’installe dans le lit, je serre le garrot avant de piquer puis je m’en libère. L’aiguille…
Le soulagement…
La chaleur monte le long de mes veines.
Je ferme les yeux, les tremblements cessent, les larmes aussi, tout s’éloigne doucement…
Commentaires
#1

- Jehol
Psycho junior - 27 octobre 2025 à 17:07
Salut,
Juste pour te dire de continuer à écrire et à poster ici.
J'aime beaucoup te lire et même si je ne commente pas tout ce que tu post de ton futur bouquin, saches que je te lis.
Ton style est fluide, sans répétitions ni longueurs... c'est agréable.
Continues, ne lâches pas l'affaire
Juste pour te dire de continuer à écrire et à poster ici.
J'aime beaucoup te lire et même si je ne commente pas tout ce que tu post de ton futur bouquin, saches que je te lis.
Ton style est fluide, sans répétitions ni longueurs... c'est agréable.
Continues, ne lâches pas l'affaire

#2

- marycora
Nouveau Psycho
- 27 octobre 2025 à 20:50
Jehol a écrit
Juste pour te dire de continuer à écrire et à poster ici.
Salut, Merci beaucoup :-)
Psychoactif
Psychoactif est une communauté dédiée à l'information, l'entraide, l'échange d'expériences et la construction de savoirs sur les drogues, dans une démarche de réduction des risques. Droit d'auteur : les textes de Psychoactif de https://www.psychoactif.org sont sous licence CC by NC SA 3.0 sauf mention contraire.
Affichage Bureau - A propos de Psychoactif - Politique de confidentialité - CGU - Contact -
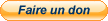 Soutenez PsychoACTIF
Soutenez PsychoACTIF