Menu blogs
Deux ex ou le mythe d'Icare ->>
<<- Présentation d'un toxicomane en col blanc. Pourquoi suis je ici ?
L’homme qui voulait devenir quelqu’un, et qui a rencontré la coke
11 janvier 2026 à 15:14
Pas un héros. Pas un sage.
Quelqu’un qui tient. Quelqu’un de crédible. Quelqu’un avec du charisme.
Un costume, des responsabilités, une image propre. Un mec qui avance.
Et puis la coke est entrée dans l’équation.
Au début, je n’ai rien vu venir.
Ou plutôt si : j’ai vu, mais j’ai accepté.
Quand je me suis rendu compte que c’était tous les jours, il était déjà trop tard pour faire semblant. Tous les jours, ce n’est plus un usage. C’est un rythme. Une nécessité.
La coke m’a donné ce qui me manquait : de la confiance en moi.
Pas une vraie confiance. Une confiance chimique. Instantanée. Artificielle.
Mais sur le moment, ça suffisait.
Puis j’ai commencé à me mentir.
Quelques mois après le départ. D’abord doucement. Puis plus franchement.
Je rentrais plus tôt pour consommer.
Je consommais au travail.
Je m’organisais autour du produit sans même m’en rendre compte.
Et c’est là que ça devient dégueulasse.
La scène qui me revient le plus souvent, c’est celle-là :
m’arrêter sur une aire d’autoroute, aller dans la douche des routiers pour prendre ma dose, puis m’enfuir en courant dans la rue, persuadé d’être poursuivi. Le cœur qui explose, la parano, la honte, la fuite. Voilà la réalité. Pas le fantasme.
Mon corps a commencé à parler avant moi.
La perte de poids.
Puis les convulsions. Plusieurs fois.
Me réveiller dans les bras de ma femme, la maison retournée, les objets renversés, elle terrorisée.
Et moi, convaincu que si je ne pensais pas consciemment à mon cœur battant, il allait s’arrêter. Comme si ma survie dépendait de ma capacité à le contrôler par la pensée.
La coke ne te rend pas invincible.
Elle te rend prisonnier de ton propre corps.
La seule personne qui a vraiment vu, c’est ma femme.
Elle a vu sans toujours pouvoir agir.
Et ça, ça laisse des traces.
J’ai perdu beaucoup de choses.
Des relations. De la crédibilité. De l’argent — beaucoup d’argent.
Mais j’ai surtout perdu quelque chose d’étrange : l’ignorance.
Et j’ai perdu le flash. Cette lumière brutale, ce frisson orgasmique que je sais aujourd’hui que je ne retrouverai jamais. Et une partie de moi le regrette encore.
Je suis parti à Mayotte pour arrêter.
Pas pour réduire. Pas pour réfléchir. Arrêter.
Les 48 premières heures ont été un enfer. Un vrai.
Agitation, rage, impossibilité de rester en place.
À un moment, j’ai pris un sac à dos et je suis parti marcher en ligne droite, sans destination. Juste pour ne pas exploser.
Aujourd’hui, ça fait un mois et demi que je n’ai pas consommé.
Je ne suis pas guéri.
Les cravings sont toujours là.
Quand ils arrivent, je repense aux flashs. Je les liste mentalement. Je les revis presque.
Puis je repense à Mayotte. Aux bras gonflés. À la stigmatisation. À la violence du système. Et parfois, ça suffit à tenir.
Ce qui me met encore en danger ?
La solitude.
L’inaction.
Le vide.
J’ai longtemps cru que je consommais à cause du stress. En réalité, je consommais pour répondre à une injonction : avoir du charisme, tenir le rôle, être à la hauteur.
Aujourd’hui, il y a des choses que je refuse.
Refuser de renier mes valeurs.
Parce que j’ai compris lesquelles étaient non négociables.
L’humain. L’humanité. Ça ne se négocie pas.
Ma plus grande peur n’est pas la rechute spectaculaire.
C’est la reconsommation silencieuse.
Et si ça arrive, j’aimerais qu’on comprenne une chose :
ce n’est peut-être qu’une passade. Et je ne devrais pas être obligé de mentir.
La société ne comprend pas.
Le costume-cravate n’y change rien.
Cadre supérieur ou pas, la dépendance s’en fout.
Le manque est le même. Le craving est le même. La chute est la même.
Croire que ça n’arrive qu’aux autres est un mensonge confortable.
Je n’écris pas pour donner une leçon.
J’écris pour ceux qui pensent que c’est devenu indispensable.
Et surtout, j’écris pour moi.
Parce que le combat est loin d’être terminé.
Et parce que regarder la vérité en face reste, aujourd’hui encore, ma meilleure chance de tenir.

- marnowi
psycho-fan
- 11 janvier 2026 à 18:18
Je passe en coup de vent, je suis actuellement en "sevrage de fait" de c (vacances en famille à 10000 bornes de mon plan), alors ton témoignage me parle.
D'ailleurs, Mayotte avait aussi été ma dernière période de pause, 7 jours d'arrêt avant une période de re-consommation spectaculaire!
J'en suis aussi à voir ma balance bénéfices-risques pencher dangereusement vers les seconds, sans pour autant parvenir à lever le pied. Enfin si, si j'arrête de me juger sévèrement, j'ai moins consommé les 2 ou 3 dernières semaines.
Je voulais m'en faire un dernier avant de partir en vacances, le plan s'est avéré plus galère que prévu (et c'est là que je vois que j'ai quand même un gros problème avec la frustration, parce que c'est le genre de trucs qui me rend complètement marteau, de devoir attendre des heures, avec le plan qui recule d'heure en heure, je suis incapable de penser à autre chose ou de faire autre chose).
J'étais hyper sur les nerfs, et du coup en décalage total avec mon conjoint et ma petite dernière qui préparaient joyeusement les valises pour les vacances. Ca m'a peinée, et j'ai décidé que ce soir là ce serait non, il était trop tard, ça n'avait plus de sens vu l'heure de départ le lendemain.... Et quand j'ai enfin reçu le message comme quoi c'était bon, ben j'ai décliné.
Quand on est aussi avancés dans l'addiction (j'ai repris l'injection et j'ai perdu le contrôle, même si c'était "moins pire" sur les 2 dernières semaines), il faut savoir prendre les minuscules victoires pour ce qu'elles sont: des victoires, point.
Comme souvent quand je change de contexte, je n'ai pas trop de craving, en tous cas rien d'insurmontable, rien à voir avec quand j'ai un plan à dispo et que j'essaye d'espacer.
Hormis la 1e nuit où j'ai très mal dormi et où à chaque fois que je parvenais à me rendormir, j'étais ramenée à préparer mon fix, que je ne pouvais jamais m'envoyer parce que j'étais toujours interrompue et ça se terminait par un réveil au moment où je pouvais enfin envoyer..... J'avoue que j'étais un peu sur les dents le matin!
Pour l'instant je ne me projette pas, on verra bien où ces 10 jours de pause me mènent....
Merci de ton témoignage en tous cas, ce que tu dis de l'évolution du craving est plutôt encourageant!
Marnowi

- Colblanctoxico
Nouveau membre
- 11 janvier 2026 à 21:03
Merci pour ton message. Il m’a vraiment touché.
Ce que tu racontes sur la nuit, sur ces rêves où tu prépares ton fix sans jamais pouvoir l’envoyer… ça m’a poursuivi longtemps aussi. Même quand le corps est loin, la tête continue. Lire ça chez toi m’a fait écho, fort.
Je n’ai pas d’enfants, mais je comprends très bien ce que tu dis sur le décalage avec la famille. De mon côté, ma femme a eu une place centrale. Elle a énormément souffert, souvent sans comprendre ce qui se passait vraiment. Et ça pèse. Pas comme une injonction, mais comme une présence constante, parfois douloureuse, parce qu’on sait ce que nos choix leur font vivre.
Je t’admire sincèrement pour ce moment où tu as dit non, alors que le plan arrivait enfin, en pleine nuit. Moi, je n’ai jamais vraiment eu cette force-là. Quand le plan arrivait, je cédais. Ce qui m’a parfois freiné, c’était plus trivial : la radinerie (avec un peu d’humour), et surtout la peur de la qualité du produit. Comme quoi, on tient parfois pour des raisons bancales… mais tenir reste tenir.
Quand tu parles des minuscules victoires, ça me parle énormément. Partir à Mayotte, pour moi, a été un choix impulsif : j’ai appelé Air France et j’ai demandé « quand est votre prochain vol pour loin ? ». Sur le moment, ça ressemblait à rien. Avec le recul, ça a eu de grandes conséquences. Dans notre monde, on n’a souvent que ça : des petits choix, des petits décalages. Repousser un réapprovisionnement de 12 heures, tenir un craving une heure de plus… ce sont déjà des victoires, même si elles ne ressemblent pas à ce qu’on nous vend comme un “vrai” arrêt.
S’il y a une chose que j’ai apprise, c’est d’essayer de ne pas me mentir à moi-même, et surtout de ne pas me détruire avec la culpabilité. Ce n’est pas après s’être injecté qu’il faut regretter. Ni après avoir dépensé. Et même pas forcément quand on décide de consommer. La culpabilité ronge parfois autant que le produit, et elle n’aide pas à avancer.
Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu aimerais garder de ces 10 jours, même si la suite reste floue ?
Merci encore pour ton témoignage.
Et prends soin de toi pendant ces 10 jours, vraiment.
- Zigou32
Nouveau Psycho
- 12 janvier 2026 à 01:16
marnowi a écrit
Salut,
Je passe en coup de vent, je suis actuellement en "sevrage de fait" de c (vacances en famille à 10000 bornes de mon plan), alors ton témoignage me parle.
D'ailleurs, Mayotte avait aussi été ma dernière période de pause, 7 jours d'arrêt avant une période de re-consommation spectaculaire!
J'en suis aussi à voir ma balance bénéfices-risques pencher dangereusement vers les seconds, sans pour autant parvenir à lever le pied. Enfin si, si j'arrête de me juger sévèrement, j'ai moins consommé les 2 ou 3 dernières semaines.
Je voulais m'en faire un dernier avant de partir en vacances, le plan s'est avéré plus galère que prévu (et c'est là que je vois que j'ai quand même un gros problème avec la frustration, parce que c'est le genre de trucs qui me rend complètement marteau, de devoir attendre des heures, avec le plan qui recule d'heure en heure, je suis incapable de penser à autre chose ou de faire autre chose).
J'étais hyper sur les nerfs, et du coup en décalage total avec mon conjoint et ma petite dernière qui préparaient joyeusement les valises pour les vacances. Ca m'a peinée, et j'ai décidé que ce soir là ce serait non, il était trop tard, ça n'avait plus de sens vu l'heure de départ le lendemain.... Et quand j'ai enfin reçu le message comme quoi c'était bon, ben j'ai décliné.
Quand on est aussi avancés dans l'addiction (j'ai repris l'injection et j'ai perdu le contrôle, même si c'était "moins pire" sur les 2 dernières semaines), il faut savoir prendre les minuscules victoires pour ce qu'elles sont: des victoires, point.
Comme souvent quand je change de contexte, je n'ai pas trop de craving, en tous cas rien d'insurmontable, rien à voir avec quand j'ai un plan à dispo et que j'essaye d'espacer.
Hormis la 1e nuit où j'ai très mal dormi et où à chaque fois que je parvenais à me rendormir, j'étais ramenée à préparer mon fix, que je ne pouvais jamais m'envoyer parce que j'étais toujours interrompue et ça se terminait par un réveil au moment où je pouvais enfin envoyer..... J'avoue que j'étais un peu sur les dents le matin!
Pour l'instant je ne me projette pas, on verra bien où ces 10 jours de pause me mènent....
Merci de ton témoignage en tous cas, ce que tu dis de l'évolution du craving est plutôt encourageant!
Marnowi
Tu peux dire que c'est avec ton voyage à Mayotte que ça t'a fait réaliser que tu ne méritait pas ça?
C'est donc à cause de la société en France que c'était moins facile à réaliser et t'a pu le voir en étant à l'étranger ??
Bon message en tout cas tu peux être fier de toi.
Merci ça fait plaisir de lire ça je suis dans la même galère je vois que ça n'est pas dans mes valeurs mais quand tu es dans le guidon tu dois être fort pour relever la tête...
- Zigou32
Nouveau Psycho
- 12 janvier 2026 à 01:20
marnowi a écrit
Salut,
Je passe en coup de vent, je suis actuellement en "sevrage de fait" de c (vacances en famille à 10000 bornes de mon plan), alors ton témoignage me parle.
D'ailleurs, Mayotte avait aussi été ma dernière période de pause, 7 jours d'arrêt avant une période de re-consommation spectaculaire!
J'en suis aussi à voir ma balance bénéfices-risques pencher dangereusement vers les seconds, sans pour autant parvenir à lever le pied. Enfin si, si j'arrête de me juger sévèrement, j'ai moins consommé les 2 ou 3 dernières semaines.
Je voulais m'en faire un dernier avant de partir en vacances, le plan s'est avéré plus galère que prévu (et c'est là que je vois que j'ai quand même un gros problème avec la frustration, parce que c'est le genre de trucs qui me rend complètement marteau, de devoir attendre des heures, avec le plan qui recule d'heure en heure, je suis incapable de penser à autre chose ou de faire autre chose).
J'étais hyper sur les nerfs, et du coup en décalage total avec mon conjoint et ma petite dernière qui préparaient joyeusement les valises pour les vacances. Ca m'a peinée, et j'ai décidé que ce soir là ce serait non, il était trop tard, ça n'avait plus de sens vu l'heure de départ le lendemain.... Et quand j'ai enfin reçu le message comme quoi c'était bon, ben j'ai décliné.
Quand on est aussi avancés dans l'addiction (j'ai repris l'injection et j'ai perdu le contrôle, même si c'était "moins pire" sur les 2 dernières semaines), il faut savoir prendre les minuscules victoires pour ce qu'elles sont: des victoires, point.
Comme souvent quand je change de contexte, je n'ai pas trop de craving, en tous cas rien d'insurmontable, rien à voir avec quand j'ai un plan à dispo et que j'essaye d'espacer.
Hormis la 1e nuit où j'ai très mal dormi et où à chaque fois que je parvenais à me rendormir, j'étais ramenée à préparer mon fix, que je ne pouvais jamais m'envoyer parce que j'étais toujours interrompue et ça se terminait par un réveil au moment où je pouvais enfin envoyer..... J'avoue que j'étais un peu sur les dents le matin!
Pour l'instant je ne me projette pas, on verra bien où ces 10 jours de pause me mènent....
Merci de ton témoignage en tous cas, ce que tu dis de l'évolution du craving est plutôt encourageant!
Marnowi
Tu peux dire que c'est avec ton voyage à Mayotte que ça t'a fait réaliser que tu ne méritait pas ça?
C'est donc à cause de la société en France que c'était moins facile à réaliser et t'a pu le voir en étant à l'étranger ??
Bon message en tout cas tu peux être fier de toi.
Merci ça fait plaisir de lire ça je suis dans la même galère je vois que ça n'est pas dans mes valeurs mais quand tu es dans le guidon tu dois être fort pour relever la tête...
Je vois que je deviens plus ce que j'étais donc ça doit changer pour le mieux on verra comment arrive le déclic je voudrais bien ton retour d'expériences là-dessus Mec merci
Ça me bouffe ma vie et à cause de ça mon entourage m'échappe ça me tue..
Tu fini par écouter tout le monde sauf toi tu te perds encore plus vers la mauvaise direction.

- Colblanctoxico
Nouveau membre
- 17 janvier 2026 à 19:12
Je me rappelle, je venais de me prendre la tête avec ma femme, qui a enduré mes "effroyables humeurs, suspendue à sa Croix" (pour ceux qui ont la ref), j'ai décroché le téléphone fixe (lol) et j'ai composé le numéro de Air France, la demande fut courte :
- "Votre prochain vol pour loin".
L'opératrice, perturbée :
- "Mamoudzou ?",
- "Banco"
C'est le fait de me retrouver seul face au manque, face à la souffrance, et à l'impossibilité matérielle de me fournir qui m'a fait réagir que si je ne voulais plus revivre ce moment, il fallait que j'arrête.
En France, mon dealer me livrait dans ma boite aux lettres, il m'arrivait même d'y laisser ma carte bleue pour qu'il aille retirer ... Imaginez la facilité et la tentation.
C'est toujours facile à dire. Je sais qu'un jour je recommencerais, j'essaie de reculer l'échéance.
Affichage Bureau - A propos de Psychoactif - Politique de confidentialité - CGU - Contact -
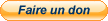 Soutenez PsychoACTIF
Soutenez PsychoACTIF